Sommaire
ToggleDes métiers autrefois …
Dans les bourgs et villes du Moyen Âge, après l’An Mil, les artisans s’organisent sous forme d’associations professionnelles, les « corps de métiers ». Certains métiers n’existent plus, d’autres existent encore mais beaucoup de métiers restent inconnus. Connaissions-nous leurs activités et quelle rapprochement pouvons-nous en faire dans notre société ?
Corporations de métiers au Moyen Age : origine, première organisation des associations ouvrières
(D’après « Etude sur l’industrie et la classe industrielle à Paris
au XIIIe et au XIVe siècle », paru en 1877)
L’histoire ne nous fait pas assister à la formation des corporations de métiers ; quand elles nous apparaissent dans les documents, notamment dans une charte de 1160 datant du roi Louis VII, elles comptent déjà de longues années d’existence et nous offrent une organisation complète. Pourtant il n’est peut-être pas impossible, en rapprochant certains traits de cette organisation de quelques textes mérovingiens et carolingiens, de se représenter ce qu’était l’industrie avant les corps de métiers, ainsi que la façon dont ceux-ci prirent naissance.
Lorsque les Francs s’établirent en Gaule et s’approprièrent les domaines du fisc impérial et ceux qui avaient été abandonnés par leurs propriétaires — les Francs avec lesquels Clovis conquit la Gaule jusqu’à la Seine étaient peu nombreux ; les terres du domaine public et les terres sans maître leur suffirent et ils ne dépouillèrent pas les Gallo-Romains d’une partie de leurs propriétés, comme le firent les Burgondes et les Visigoths —, les artisans fixés sur ces domaines durent travailler pour leurs nouveaux maîtres. Les uns restèrent isolés et conservèrent leur fonds colonaire à la charge de fournir des produits de leur industrie.
La plupart furent distribués, suivant leurs métiers, dans des ateliers dont chacun était dirigé par une sorte de contremaître (ministerialis). La nombreuse domesticité du conquérant germain comprenait donc tous les artisans dont l’industrie lui était nécessaire. Dans les gynécées, des femmes se livraient au cardage de la laine, au tissage, au lainage, au foulage et à la teinture des étoffes à l’aide des matières livrées par l’intendant du domaine (Capitulaires de Villis, cap. 43 et 49), et Guérard, Prolégomènes du Polyptioque d’Irminon).
Le maître tirait un profit pécuniaire des talents de ses esclaves en vendant les produits de leur industrie ou en louant leurs bras à prix d’argent. Si la responsabilité du maître prouve qu’il profitait en partie de l’argent gagné par l’esclave, le mot permiserit qui apparaît dans les lois burgondes suppose que celui-ci était intéressé à travailler pour le public et qu’il gardait une partie du salaire. Les plus habiles avaient pour lui une grande valeur à cause des bénéfices qu’ils lui rapportaient. Aussi celui qui tuait un esclave initié à un art mécanique payait au maître un wergeld plus élevé lorsque cet esclave avait donné des preuves publiques d’habileté (publice probati).
C’est à ces ouvriers travaillant à la fois au profit de leur maître et à leur profit personnel, que s’adressaient les hommes libres qui n’étaient pas assez riches pour entretenir des esclaves aussi nombreux, aussi experts que l’exigeaient leurs besoins. Les villages possédaient aussi des moulins et des forges, où des agents, ayant un caractère public, travaillaient pour les membres de la communauté. Enfin il y avait dans les villes quelques artisans libres. Mais on n’en a pas moins le droit de dire que, pendant la période mérovingienne et la période carolingienne, le travail industriel eut en général un caractère domestique et servile.
C’est de ces groupes d’artisans créés dans les domaines des grands propriétaires que sortirent les corps de métiers du Moyen Age. Une organisation, imaginée dans l’intérêt du maître pour discipliner et rendre plus productif le travail servile, devint la garantie des privilèges de la classe industrielle, la source de sa prospérité. Cette transformation s’accomplit par degrés ; l’artisan réussit d’abord à s’assurer une partie des bénéfices de son travail, et nous venons de voir que, dès le VIe siècle, il avait parfois franchi ce premier pas, puis le maître les lui abandonna entièrement en stipulant seulement des droits pécuniaires, enfin les associations ouvrières s’attribuèrent des privilèges exclusifs qui firent disparaître les travailleurs isolés. Parvenues à une indépendance complète, elles conservaient encore, nous le verrons, des traces de leur origine. Le mouvement communal ne fut pour rien dans cette émancipation de la classe ouvrière, elle était terminée quand il commença, et ce fut, au contraire, l’existence des corporations qui favorisa la formation des communes.
Si la plupart des corporations de métiers ont l’origine que nous venons d’indiquer, il en est cependant quelques-unes qui descendent directement des collèges romains. Parmi les corporations parisiennes, celles des marchands de l’eau et des bouchers de la Grande-Boucherie doivent remonter à l’époque romaine. Les nautes parisiens, qu’une inscription nous montre dès l’époque de Tibère consacrant un autel à Jupiter, survécurent à l’invasion franque et ne perdirent rien de leur importance, puisqu’ils formèrent la municipalité parisienne. La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie se recrutait héréditairement, et cette particularité, qu’on ne rencontre dans aucune autre corporation de la capitale, fait inévitablement penser aux collèges romains chargés de l’alimentation publique, dont les membres étaient également héréditaires.
A ces deux exceptions près, on ne peut retrouver les collegia opificum dans les corps de métiers du Moyen Age. Aucun texte n’indique la persistance de ces collèges, tandis que nous en avons cité plusieurs qui témoignent de l’existence d’un régime industriel tout différent. Si, faisant abstraction des textes qui sont loin, il faut bien en convenir, d’être tout à fait topiques et concluants, on cherche à se représenter ce qui s’est passé lorsque les Francs ont occupé Paris, on est porté à penser qu’ils firent subir aux membres des collèges le sort de leurs esclaves germains, qu’ils les réduisirent à un état voisin de la servitude pour s’assurer leurs services.
Des associations, dont les membres étaient enchaînés à leur profession dans un intérêt public, n’étaient pas faites pour être respectées ni même comprises par un peuple qui ne s’était pas encore élevé jusqu’à la notion de l’État. Faut-il admettre qu’une partie des gens de métiers échappa à la servitude et, pour protéger son indépendance, forma des guildes que le temps transforma en corps de métiers ? Il semble que non, et le petit nombre d’artisans qui avaient conservé leur liberté, comme le tailleur dont parle Grégoire de Tours, ne tarda pas, vraisemblablement, à disparaître.
Mais hâtons-nous de renoncer aux conjectures pour aborder une époque où le secours des textes ne nous fera plus défaut. Il faut arriver à la seconde moitié du XIIe siècle pour trouver les premières traces de l’existence des corporations. Cette existence se révèle pour la première fois dans une charte de 1160 par laquelle Louis VII concède à Thèce Lacohe les revenus des métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers et boursiers. Il résulte implicitement de cette charte que ces cinq métiers étaient exercés par autant de corporations. La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie remontait, nous l’avons dit, à l’époque romaine ; on ne s’étonnera donc pas de voir leurs usages qualifiés d’antiques en 1162, lorsque Louis VII les remit en vigueur. Les drapiers qui, en 1183, prirent à cens des maisons de Philippe-Auguste faisaient par-là même acte de corporation. Enfin c’est au même prince que plusieurs corps de métiers font remonter certains privilèges consignés dans les statuts du Livre des métiers de Boileau (vers 1260).

La Grande Boucherie à Paris
Du reste le fond de ces statuts pris dans leur ensemble a une origine bien antérieure à l’époque où ils furent rédigés. C’est ce qui fait leur importance. Nous n’avons pas besoin de dire qu’Etienne Boileau n’a pas donné aux corporations leurs règlements ; cela est trop évident. Il n’a pas même, comme les auteurs de nos codes, fait un choix parmi les coutumes de ces corporations dans des vues d’harmonie, d’équité et de progrès. Il s’est contenté de les recueillir par écrit telles que les gens de métiers les lui firent connaître, sans faire disparaître leurs contradictions, sans résoudre les questions soulevées par les requêtes de plusieurs corporations.
Dans ces statuts une seule chose lui appartient : le plan. S’ils gardent en effet le silence sur une foule de points, ils s’occupent toujours, et cela dans un ordre uniforme, de la franchise ou de la vénalité du métier, du nombre des apprentis et des gardes-jurés, des impôts et du guet. Leurs nombreuses lacunes ne doivent pas plus nous étonner que l’époque relativement tardive à laquelle ils ont été rédigés ; la tradition qui avait permis de se passer pendant si longtemps de règlements écrits, suppléait à leur silence. En dépit de leur laconisme, les statuts de Boileau ont une haute valeur, et parce qu’ils reflètent un état de choses bien plus ancien et parce qu’ils conservèrent longtemps leur autorité et servirent de base à la législation postérieure.
Avant d’exposer l’organisation de l’industrie parisienne, il faut dire quelques mots du développement auquel elle était parvenue. Les chroniques et les autres compositions historiques ne contribuent presque pour rien à l’idée que nous pouvons nous en faire. L’Eloge de Paris, composé en 1323 par Jean de Jandun, est presque le seul document de ce genre qui nous fournisse à cet égard quelques renseignements ; encore n’ont-ils pas toute la précision désirable. A défaut de précision, on découvre du moins, sous l’obscurité et le pédantisme de son style, la vive impression produite sur l’auteur par l’industrie et le commerce de la capitale. Renonçant à décrire tout ce qu’il a vu aux Halles, dans ces Halles que Guillebert de Metz nous dépeindra au siècle suivant comme aussi vastes qu’une ville,Jean de Jandun se borne à signaler les provisions considérables de draps, les fourrures, les soieries, les fines étoffes étrangères exposées au rez-de-chaussée, et, dans la partie supérieure qui présente l’aspect d’une immense galerie, les objets de toilette, couronnes, tresses, bonnets, épingles à cheveux en ivoire, besicles, ceintures, aumônières, gants, colliers.
Les divers ornements destinés aux fêtes, nous dit-il dans un style que nous sommes obligé de simplifier pour le rendre intelligible, fournissent à la curiosité un aliment inépuisable. Jean de Jandun exprime d’une façon vive et frappante le développement de l’industrie parisienne, en déclarant qu’on ne trouvait presque pas deux maisons de suite qui ne fussent occupées par des artisans. Ce trait est ce qu’il y a de plus intéressant dans le court chapitre consacré par lui aux professions manuelles et où il se contente d’énumérer un certain nombre de métiers, sans donner de particularités sur aucun d’eux. Cette énumération comprend l’art de la peinture, de la sculpture et du relief, l’armurerie et la sellerie, la boulangerie, dont les produits sont d’une exquise délicatesse, la poterie de métal, enfin les industries des parcheminiers, des copistes, des enlumineurs et des relieurs.
Heureusement nous ne sommes pas réduits à cette vague description pour nous représenter l’état de l’industrie parisienne au XIIIe et au XIVe siècles. Les rôles des tailles levées à Paris de 1292 à 1300, puis en 1313 nous offrent des informations plus précises. On y trouve rue par rue la liste de tous les artisans soumis à la taille, avec l’indication de leur cote. Ces documents officiels pourraient donc servir de base à une statistique de l’industrie parisienne, s’ils contenaient le recensement de toute la population ouvrière. Mais les simples ouvriers n’y figurent qu’en petit nombre ; et les patrons eux-mêmes n’y sont pas tous compris. Toutefois, si ces rôles ne nous font pas connaître l’ensemble de la population industrielle, ils permettent du moins de s’en faire une idée approximative, ainsi que du nombre des artisans de chaque métier ; ils nous indiquent en même temps la répartition des diverses corporations dans Paris et par la cote de leurs membres, leur prospérité relative.
Géraud a fait le relevé des gens de métiers mentionnés dans le rôle de 1292 ; leur nombre, si on exclut de cette liste tous ceux qui n’exerçaient pas l’industrie proprement dite, s’élève à 4159. Le même travail effectué pour le rôle de 1300 permet de dénombrer 5844 contribuables voués aux professions mécaniques. Un assez grand nombre de contribuables, dont la profession est indiquée dans le règlement de 1300, sont inscrits sans cette indication dans celui de 1292, et par conséquent ne sont pas entrés dans le recensement de Géraud ; on peut aussi supposer que celui-ci a vu maintes fois un surnom là où nous avons cru reconnaître une qualification professionnelle. Toutefois ces raisons ne suffisent pas à expliquer une différence de 1685 contribuables et il faut en chercher la cause soit dans l’augmentation de la population ouvrière de 1292 à 1300, soit dans l’assiette de la taille à ces deux époques, assiette qui nous est malheureusement inconnue.
Disons maintenant dans quelles branches d’industrie Paris se distinguait et s’était fait une réputation. La draperie parisienne, sans atteindre le même développement que celle de Flandre, avait pris une assez grande extension. La capitale était une des villes « drapantes » qui composaient la hanse de Londres. L’étoffe de laine qu’on y fabriquait sous le nom de biffe jouissait d’une grande renommée. Le Dit du Lendit rimé parle des draps parisiens qui sont également mentionnés dans les tarifs des marchandises vendues aux foires de Champagne. De tous les gens de métiers inscrits dans le rôle de 1313, les drapiers sont certainement les plus imposés, et par conséquent les plus riches. Il en est dont la cote s’élève à 24 livres, à 30 livres, à 127 livres, à 135 livres, et c’est un drapier qui supporte la plus forte contribution du rôle, qui est de 150 livres.
La mercerie était aussi très florissante à Paris et y attirait un grand concours de marchands de tous les pays. Le Dit des marchéans, à la suite des Proverbes et dictons populaires publiés par Crapelet, stipule : « Et reviennent de toz païs / Les bons marcheans à Paris / Por la mercerie achater ». Le commerce des merciers comprenait des objets très divers, dont la fabrication exigeait déjà ce goût et ce savoir-faire qui recommandèrent plus tard les produits parisiens à l’étranger (voir le même Dit, ainsi que le Dit des merciers). Enfin la bijouterie parisienne était très estimée, à en juger par des vers du roman d’Hervis qui la mettent sur le même rang que les draps de Flandre (voir les Etudes sur les foires de Champagne, par Bourquelot).
L’activité industrielle et commerciale se déployait surtout sur la rive droite de la Seine qu’on appelait le quartier d’outre Grand-Pont. Les artisans de même profession étaient fréquemment groupés dans le même quartier ; mais il ne faut pas considérer cet usage comme étant d’une constance absolue, car les artisans et les consommateurs avaient un intérêt commun à ce que chaque industrie n’eût pas un centre unique, les premiers pour ne pas se faire une concurrence préjudiciable, les seconds pour trouver à leur portée les produits dont ils avaient besoin. Aussi, quand on parcourt les registres des tailles de 1292, de 1300 et de 1313, ne s’étonne-t-on pas de la diversité des métiers qui s’exerçaient, pour ainsi dire, cote à côte. Cependant le nom seul de certaines rues, qui s’est conservé jusqu’à nos jours, prouverait qu’elles étaient, à l’origine du moins, le siège d’une industrie spéciale.
Le nom de la Mortellerie est expliqué par le passage suivant : « …en la rue de la Mortèlerie, devers Saine, où l’on fait les mortiers… » (Cartulaire de Notre-Dame, III). La population de la Tannerie se composait en majorité de tanneurs (Livre de la taille de 1313). Les selliers, les lormiers et les peintres étaient domiciliés en grand nombre dans la partie de la Grant Rue ou rue Saint-Denis, qui s’étendait depuis l’hôpital Sainte-Catherine jusqu’à la porte de Paris, et qui était appelée la Sellerie. La rue Erembourg de Brie portait aussi le nom de rue des Enlumineurs, qu’elle devait à la profession de ses habitants composés presque exclusivement d’enlumineurs, de parcheminiers et de libraires (Recherches sur Paris, par Jaillot ; Antiquités de Paris, par Sauval ; Rôle de 1292 ; Rôle de 1300).
C’était dans les rues Trousse-Vache et Quincampoix que les marchands de tous les pays venaient s’approvisionner de mercerie (le Dit des marchéans). Les tisserands étaient établis dans le quartier du Temple, rue des Rosiers, des Ecouffes, des Blancs-Manteaux, du Bourg-Thibout, des Singes ou Perriau d’Etampes, de la Courtille-Barbette et Vieille-du-Temple. Jean de Garlande nous apprend que les archers, c’est-à-dire les fabricants d’arcs, d’arbalètes, de traits et de flèches, avaient élu domicile à la Porte Saint-Ladre. On comptait un grand nombre de fripiers dans la paroisse des Saints-Innocents (Livre de la taille de 1313). Les attachiers demeuraient sur la paroisse Saint-Merry, car, durant le carême, ils cessaient de travailler quand compiles sonnaient à cette église.
Ces agglomérations, dont nous pourrions donner d’autres exemples, s’expliquent par plusieurs causes. D’abord, les membres d’une association, unis par des occupations et des intérêts communs, ont une tendance naturelle à se grouper. Indépendamment de cette cause générale, plusieurs corps de métiers étaient attirés dans certains quartiers par les exigences de leurs industries, d’autres ne pouvaient s’en écarter pour des raisons d’hygiène ou de police. Certaines industries, telles que la teinturerie, ne pouvaient s’exercer que dans le voisinage d’un cours d’eau. Au mois de février 1305 (n. s.), Philippe le Bel rétablit les changeurs sur le Grand-Pont, qu’ils occupaient déjà avant sa destruction, et défendit de faire le change ailleurs. Il est aisé de découvrir le motif de cette interdiction : le commerce de l’argent, se prêtant à des fraudes nombreuses, nécessitait une surveillance active que la réunion des changeurs dans un lieu aussi fréquenté que le Grand-Pont, rendait beaucoup plus facile.
C’est sans doute pour la même raison que le prévôt de Paris assigna aux billonneurs une place nouvellement créée vis-à-vis de l’Écorcherie, au bout de la Grande-Boucherie. Plusieurs obtinrent de rester dans la rue au Feurre, en représentant qu’elle était située au centre de Paris, près de la rue Saint-Denis, la plus commerçante de la ville, et dans le voisinage des Halles. Les billonneurs domiciliés sur le Grand et le Petit-Pont furent compris dans cette exception, les autres durent se conformer à la mesure prise par le prévôt’. En 1395, le procureur du roi au Châtelet voulait obliger les mégissiers qui corroyaient leurs cuirs dans la Seine depuis le Grand-Pont jusqu’à l’hôtel du duc de Bourbon, à transporter plus en aval leur industrie, parce qu’elle corrompait l’eau nécessaire aux riverains et aux habitants du Louvre et dudit hôtel.
L’intérêt de la salubrité publique avait fait placer les boucheries hors de la ville, parce qu’à cette époque on avait l’habitude d’y abattre et d’y équarrir les bestiaux. La Grande-Boucherie ne fit partie de Paris que depuis l’agrandissement de la capitale par Philippe-Auguste. Elle était située au nord du Grand-Châtelet, et désignée aussi sous les noms de boucherie Saint-Jacques, du Grand-Châtelet et de la porte de Paris. Elle se composait de trente et un étaux et d’une maison commune nommée, le four du métier, parce que le maître et les jurés y tenaient leurs audiences. Les étaux des bouchers de Sainte-Geneviève se trouvaient dans la rue du même nom. Ils jetaient le sang et les ordures de leurs animaux et avaient fait pratiquer à cette fin un conduit qui allait jusqu’au milieu de la voie. Un arrêt du Parlement, du 7 septembre 1366, les obligea à abattre, vider et apprêter les bestiaux hors Paris, au bord d’une eau courante (Livre du Châtelet rouge).
Dom Bouillart attribue à Gérard de Moret, abbé de Saint-Germain des Prés, la création de la boucherie du bourg de ce nom. Cependant, Jaillot assure que des actes du XIIe siècle font mention des bouchers de Saint-Germain. Quoiqu’il en soit, par une charte du mois d’avril 1274-75, l’abbé Gérard loua à perpétuité aux bouchers y dénommés et à leurs héritiers seize étaux, situés dans la rue conduisant à la poterne des Frères mineurs, et appelée depuis rue de la Boucherie. Le loyer de ces seize étaux s’élevait à 20 livres tournois, payables aux quatre termes d’usage à Paris, et était dû solidairement par chaque boucher.
Le nombre ne pouvait en être augmenté ni diminué sans l’autorisation de l’abbé. Ceux qui devenaient vacants par la mort ou l’absence du locataire, ne pouvaient être loués qu’à des personnes originaires du bourg, et pour une somme qui ne devait pas dépasser 20 sous parisis. La vacance ou même la destruction de l’un d’eux n’opérait pas de réduction dans le loyer dont le taux restait fixé à 20 livres. Le défaut de paiement amenait la saisie des bien meubles de tous les bouchers ou de l’un d’eux (communiter vel divisim), jusqu’à l’acquittement intégral de la dette. L’abbaye avait aussi la faculté de confisquer leurs viandes en cas de non-paiement ou de violation d’une clause du bail. Dans la suite, les bouchers qui occupaient alors les étaux, convertirent spontanément les livres tournois en livres parisis et augmentèrent par là le loyer d’un quart.
La charte rédigée à cette occasion, le mercredi 29 mars 1374 (n. s.), constate deux autres modifications apportées au bail. Le boucher sur lequel la saisie avait été opérée pour le tout eut désormais, contre ses codébiteurs solidaires, un recours dont la première charte ne parle pas, et l’étranger qui épousait une femme native du bourg, fut admis à s’y établir boucher pendant la durée du mariage. Indépendamment de ces seize étaux, la même rue en contenait trois autres qui ne sont pas compris dans le bail. L’abbé Richard, de qui émane la charte, prévoyant le cas où ce nombre augmenterait, se réserva, ainsi qu’à ses successeurs, le droit de les louer à des bouchers connaissant bien leur état et nés à Saint-Germain.
La fondation d’une nouvelle boucherie rencontrait l’opposition des bouchers du Châtelet, qui y voyaient une atteinte à leur monopole. Ils eurent un procès devant le Parlement avec les Templiers, au sujet d’une boucherie que ceux-ci faisaient construire dans une terre, sise aux faubourgs de Paris. Les adversaires des Templiers prétendaient être en possession d’instituer leurs fils bouchers avec la faculté d’exercer cette industrie pour toute la ville, sous la condition de l’autorisation royale. Personne, disaient-ils, fût-ce un seigneur justicier, ne pouvait créer des bouchers, ni construire une boucherie à Paris ou dans les faubourgs, à l’exception de ceux qui en avaient depuis un temps immémorial.
Philippe III, avec leur assentiment, accorda aux Templiers la permission d’avoir hors des murs deux étaux, dont la longueur ne devait pas dépasser douze pieds, et d’y établir deux bouchers, qu’ils ne seraient pas obligés de prendre parmi les fils de maîtres. Il était permis à ces bouchers de faire écorcher et préparer les bestiaux par leurs garçons, mais ils étaient tenus de les dépecer et de les vendre en personne. Le roi les affranchit de tous les droits auxquels la corporation était sujette, en déclarant qu’il n’entendait pas porter atteinte par cette concession aux usages et privilèges de ladite corporation. Cette transaction, datée du mois de juillet 1282, nous fait connaître l’origine de la boucherie du Temple.
Le 2 novembre 1358, le dauphin Charles autorisa le prieuré de Saint-Éloi à établir six étaux à boucliers dans sa terre située près de la porte Baudoyer et au delà de la porte Saint-Antoine. Le prieur obtint cette faveur en faisant valoir la commodité qu’elle procurerait aux habitants du quartier Saint-Paul, dont toutes les boucheries se trouvaient fort éloignées, et l’exemple de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, qui avaient des boucheries dans les faubourgs.
L’évêque de Paris possédait un étal situé entre la grande et la petite porte de l’Hôtel-Dieu. Cette position causant beaucoup d’incommodité aux malades et aux personnes de la maison, l’évêque et l’hospice s’accordèrent pour qu’il fût transporté plus loin, dans la rue Neuve-Notre-Dame, à condition qu’il resterait sous la juridiction du prélat, et que le boucher qui l’occuperait conserverait ses privilèges. Philippe de Valois consentit à l’un et à l’autre, au mois de décembre 1345. Mentionnons enfin la boucherie du bourg de Saint-Marcel et celle du Petit-Pont, qui était sous la juridiction de Saint-Germain-des-Prés.
Crieurs publics : supports vivants de la réclame d’antan
(D’après « La publicité en France : histoire et jurisprudence », paru en 1879)
Dans les temps les plus reculés le commerce était exercé par des marchands forains ou ambulants, qui faisaient connaître leur présence dans les villes où ils passaient par le son d’un instrument quelconque alors en usage, ou bien par la voix d’un crieur annonçant leur arrivée et les marchandises qu’ils avaient à vendre. Réglementé au moins depuis 1220, le droit de criage fut plus tard étendu aux annonces officielles : décès, animaux égarés, jours des confréries…
Hérodote nous apprend que c’est en Lydie que les premières boutiques furent ouvertes par des marchands en résidence fixe. Ils avaient alors des crieurs à leur porte pour attirer les acheteurs, ainsi que cela se pratiquait encore à Paris au XIXe siècle dans les bazars ou dans les ventes et liquidations installées provisoirement au rez-de-chaussée des maisons nouvellement bâties.
Autrefois, à Rome, le crieur public était appelé Præco. Employé dans beaucoup de circonstances différentes, le Præco était chargé, devant une cour de justice, d’appeler le demandeur et le défendeur ; d’annoncer les noms des parties et de proclamer les sentences. Dans les comices, c’est lui qui convoquait les centuries, proclamait le résultat du vote de chaque centurie et les noms des élus. Dans les ventes, il annonçait les articles mis en adjudication et répétait les enchères ; dans les jeux publics, il avertissait le peuple de se rendre au théâtre et proclamait les noms des vainqueurs ; dans les assemblées, il maintenait l’ordre et le silence. Il criait aussi à son de trompe les objets perdus.
Avant qu’on ne les affichât, les lois étaient publiées, en France, par des crieurs et à son de trompe. Au Moyen Age, ces crieurs étaient des officiers publics formant une corporation régie, comme les autres, par des statuts particuliers et ayant dans Paris deux maîtres, un pour chaque rive de la Seine. Sur la gravure que nous donnons ci-dessous, et qui représente une vente à la criée, au Moyen Age, le subhastator, officier public, notaire ou commissaire, chargé de la vente, est assisté de deux crieurs (preco). L’un appelle le public en sonnant de la trompette, l’autre crie les enchères. La baguette que tient l’officier public lui servait à indiquer et à toucher l’enchérisseur auquel il venait d’adjuger.

Vente à la criée en 1557
Les marchands, les bourgeois avaient recours aux crieurs pour répandre par la ville les avis qu’ils voulaient communiquer au public, car le criage était le seul moyen de publicité d’alors. Ainsi, on criait au son des clochettes, de la trompette et du tambourin, les denrées, les décès, les invitations aux obsèques, les ordonnances de police et les objets perdus.
Le premier titre qui parle des crieurs, est un édit de Philippe-Auguste de l’an 1220. D’après ce titre, il paraît que ce droit de criage avait été tenu par un nommé Simon de Poissy, que le roi en était en possession, et le donna aux marchands de la hanse de l’eau, mercatoribus nostris hansatis aquæ, avec pouvoir d’instituer ou destituer les crieurs à leur volonté : Poterunt clamatores ponere et amovere pro voluntatibus suis. Ces officiers étaient alors uniquement employés pour le commerce. Depuis ce premier titre, il s’est encore passé près de deux siècles pendant lesquels ils n’eurent point d’autre qualité que celle de crieurs de vin, clamatores vini.
Il en est fait mention sous ce titre dans les ordonnances de saint Louis, de l’an 1268, recueillies par Étienne Boileau, prévôt de Paris, pour l’établissement en communauté de tous les corps des arts et métiers de Paris ; cette ordonnance réglait la forme de la réception de ces officiers à l’Hôtel de Ville ; comment ils devaient crier le prix des vins ; ce que les taverniers leur devaient payer ; elle mentionnait que leurs salaires pour les vins étrangers et de liqueurs, étaient plus forts, parce qu’ils étaient obligés d’aller en faire les cris devant les maisons royales. C’étaient eux qui étaient aussi chargés de porter aux taverniers les mesures, après qu’elles avaient été étalonnées à l’Hôtel de Ville ; ils avaient l’inspection sur les fraudes qui s’y pouvaient commettre, et en faisaient leurs rapports.
Les rois usaient quelquefois du droit de bon vin, pour celui qui provenait des clos de leurs domaines situés à Paris. Cela faisait fermer toutes les tavernes, et les crieurs étaient obligés d’aller ensemble crier tous les jours, le soir et le matin, le vin du Roy. Les prévôt des marchands et échevins connaissaient de tout ce qui concernait ces jurés-crieurs.
Outre le droit des crieurs, qui était de quatre deniers par jour, il était encore dû un certain droit au prévôt des marchands et échevins pour l’ouverture ou la fermeture de chaque cellier, ou taverne, selon l’importance du commerce qui s’y faisait. Les taverniers prétendirent n’être tenus de l’un ni de l’autre de ces droits : cela donna lieu à une instance au Parlement, et par arrêt du mois de mars 1274, les taverniers furent condamnés à les payer immédiatement. Ce ne fut que sous le règne de Charles VI, par une ordonnance du mois de février 1415, que l’on ajouta aux fonctions des jurez-crieurs de vins, celle d’annoncer par cris les morts, à condition que chacun d’eux n’en crierait qu’un par jour, afin qu’ils pussent être employés chacun à leur tour ; il fut aussi ordonné qu’aucune autre personne qu’eux ne s’entremettrait de fournir robes, manteaux et chapeaux pour obsèques ou funérailles, sous peine d’amende arbitraire.
On leur attribua, en même temps, le droit de crier les jours des confréries, les enfants et les animaux perdus ou égarés, et jusqu’aux légumes et autres productions de la terre qui étaient à vendre, à l’exception du bois et du foin, à condition qu’ils ne pourraient crier aucun enfant au-dessous de l’âge de huit ans, sans permission de justice.
C’est alors qu’ils commencèrent à être qualifiés jurés-crieurs de corps et de vins, et, pour cette fonction aux obsèques ou funérailles, ces mêmes lettres leur attribuèrent les salaires qui leur devaient être payés. Les jurés-crieurs furent depuis érigés en titre d’offices royaux, au nombre de 30, par lettres patentes du mois de septembre 1641. Ils furent augmentés de 20 au mois de janvier 1670, et incorporés aux anciens par déclaration du 20 février de la même année. Il y eut de semblables offices créés dans toutes les villes du royaume par différents édits.
Au XIIIe et au XIVe siècle, presque tous les marchands criaient leurs marchandises dans la ville, et allaient les offrir de porte en porte, car bien peu d’entre eux étaient assez riches pour posséder des boutiques ; au XVIe siècle, les cris diminuent et les marchands commencent à s’établir ; chaque métier se confine dans un quartier spécial. Ils ne faisaient par là que suivre les traditions anciennes. Beaucoup de ces réunions de marchands ont donné leur nom aux quartiers qu’ils habitaient, tels que le quai des Orfèvres, la rue aux Ours. Construite au XIIIe siècle, la rue aux Ours était habitée par les rôtisseurs les plus renommés de Paris ; ils excellaient surtout dans la manière de préparer les oies, alors le régal de l’artisan et du bourgeois. C’était du reste à peu près le seul rôti qu’ils vendaient, d’où leur venait le nom des rôtisseurs oyers ou oyeurs. La rue où l’on voyait sans cesse tourner leurs broches chargées de ce mets succulent fut appelée rue aux Oues, c’est-à-dire aux Oies, et lorsqu’elle cessa d’être exclusivement habitée par les Oyers, elle prit par corruption le nom de rue aux Ours, explique Paul Lacroix dans Mœurs et usages du Moyen Age.
Guillaume de Villeneuve, qui vivait au XIVe siècle, a donné dans une pièce de vers intitulée le Dit des Crieries de Paris, les différents cris des marchands ambulants, car à cette époque, non seulement on vendait sur la voie publique des légumes ou des denrées alimentaires, mais on y colportait aussi les vêtements, le vin, l’huile, la chandelle.
Le droit de faire publier n’appartenait dans chaque ville qu’au juge qui avait la juridiction ordinaire et de territoire. C’est pour cela que l’on nommait, dans chaque ville, « banlieue » l’étendue dans laquelle le juge ordinaire avait droit de faire faire les publications et afficher les ordonnances. Lors même que dans une ville il y avait plusieurs juges ordinaires, ce droit de faire publier n’appartenait qu’au premier et principal magistrat de la ville, comme une suite et dépendance de la police. Le prévôt de Paris en était en possession de temps immémorial. De là vient que l’officier uniquement chargé des publications, et les deux trompettes qui devaient l’accompagner, étaient officiers de la juridiction et soumis à sa discipline. L’institution de ces officiers est très ancienne ; on ne peut exactement en fixer l’origine. Il est seulement certain qu’ils étaient en exercice dès l’an 1396. Les proclamations s’appelaient simplement en ce temps du nom de Cris : d’où vient le nom de juré-crieur que portait cet officier.
Lorsque la Révolution de 1789 éclate, les fonctions de juré-crieur, à Paris, ne consistèrent plus guère, comme autrefois à Rome, qu’à présider aux funérailles. On ne leur avait réservé que le droit de fournir aux obsèques les tentures, manteaux et habits de deuil, comme jadis ; ils devaient « quérir et rapporter les robes, manteaux et chaperons pour les funérailles. » Dès lors, les fonctions de crieurs publics furent confondues avec celles des afficheurs et des colporteurs.
Brasseur : un métier réglementé dès le XIIIe siècle
(D’après « Le Magasin pittoresque », paru en 1880)
Fabriquée dès le IVe millénaire avant J.-C. en Mésopotamie, boisson des dieux en Egypte, la bière se serait de là répandue en Europe. Les Grecs, suivant leur coutume de faire remonter à la divinité toutes les inventions profitables aux hommes, attribuèrent à Cérès l’invention de la boisson pélusienne. C’était faire de cette déesse la rivale de Bacchus, comme on l’a écrit sur un jeton du dix-huitième siècle.
Eschyle, Sophocle, Théophraste, Polybe, Strabon, font mention de la bière, et comme aujourd’hui, dès cette époque, il y en avait de deux sortes, la douce et la forte. Pline en parle également sous le nom de cerevisia, cervoise. De ce mot on a donné bien des étymologies ; celle qui ferait venir ce vocable de Cérès n’est pas une des moins curieuses.

Jeton de la corporation des brasseurs au XVIIIe siècle
Quant aux étymologies de bière et de brasseur, elles sont, s’il est possible, encore plus bizarres : le mot hébreu beri, le verbe latin libere, le mot français bras, ont tour à tour eu l’honneur d’être mis en avant ; ce dernier, parce que les brasseurs se servent de leurs bras pour brasser. Il était inutile d’aller chercher si loin : le mot brace, que cite Pline et qui désigne le grain dont on faisait le cervoise, suffit amplement. Ce mot a subsisté au Moyen Age sous la forme brais, toujours pour désigner l’orge et le grain macérés dans l’eau dont on faisait la bière, ce que les Anglais ont appelé malt.
La bière était fabriquée partout à peu près de la même façon, mais les ingrédients employés différaient avec les pays. Le grain, quel qu’il fût, était mis dans l’eau ; après qu’il était bien macéré et entré en pleine fermentation, on le torréfiait. Réduit ensuite en farine, on le faisait bouillir : c’est ainsi qu’on obtenait la bière et la cervoise ; cependant, dans la composition de cette dernière, plus capiteuse, il entrait un plus grand nombre d’éléments. De nombreux textes attestent la préférence que nos ancêtres lui accordaient ainsi que son prix plus élevé.
Les médecins, dès l’Antiquité, discutèrent beaucoup sur les défauts ou les qualités de la bière : selon les uns, elle ne pouvait que nuire à la santé et charger l’estomac ; selon les autres, aucune boisson n’était meilleure pour maintenir le corps dans un merveilleux équilibre. L’École de Salerne a ainsi défini la bonne cervoise : « Que la cervoise n’ait pas un goût aigre ; qu’elle soit bien claire, brassée de bon grain et suffisamment vieille. »
Il n’est pas douteux que dans le nord de la France, au Moyen Age, l’usage de la bière ait été répandu. On avait peu de vin, et surtout peu de bon ; on était réduit au clairet, trop coûteux pour les buveurs de profession. Le Midi, mieux partagé, envoyait plutôt l’excédent de sa consommation en Angleterre ; les fleuves lui fournissaient un moyen de transport assez rapide et à bon marché. Force était donc aux gens du nord de se contenter du clairet, et plus souvent de l’hydromel et de la bière. C’est à cette cause qu’il faut sans doute attribuer l’immense développement et l’ancienneté des corporations de brasseurs.
A Paris, des statuts furent donnés aux cervoisiers, vers 1268, par le premier garde de la prévôté de Paris, Étienne Boileau. Mais le corps de métier, il va sans dire, était bien plus ancien. Ces statuts, rédigés d’après les renseignements fournis par les cervoisiers d’alors, ne font donc que rappeler un état de chose bien antérieur à la seconde moitié du treizième siècle : « Nul cervoisier, disent ces statuts, ne peult, ne doit faire cervoise fors de yane et de grain, c’est assavoir d’orge, de mesteuil et de dragié ; et se ils y mettent autre chose pour en faire, c’est assavoir baye (sans doute des baies de laurier ou d’autres arbres), piment ou poiz résine, et quiconques y mettroit aucunes de ces choses, il l’amenderoit au roi de vingt sous parisis, toutes les fois qu’il en seroit repris ; et si seroient tous les brasins qui seroient faits de tiez choses donnez pour Dieu. »
C’était, à vrai dire, une excellente mesure, et les prud’hommes qui disaient que telles choses « étoient mauvaises au chief et au corps, aux malades et aux sains », seraient bien étonnés s’ils voyaient ce que l’on fait entrer aujourd’hui dans la composition de la bière, et encore plus s’ils goûtaient la boisson affreuse que l’on décore si souvent de ce nom.
Du reste, pour faciliter l’exécution de ces statuts, on ne permettait qu’à peu de personnes de vendre de la bière ; les maisons des brasseurs ou leurs brasseries étaient les seuls endroits où l’on pût s’en procurer, à moins toutefois que l’on voulût en fabriquer chez soi et pour usage personnel.
A cette époque, la communauté était dirigée par deux prud’hommes. A la fin du quinzième siècle, en 1489, ces statuts furent confirmés et reçurent un plus grand développement. La communauté prit le nom de « communauté des cervoisiers et faiseurs de bière », ce qui marque bien, comme nous l’avons fait remarquer plus haut, la différence qui existait entre ces deux boissons.
La durée de l’apprentissage fut fixée à trois ans ; ce temps révolu, en payant soixante sous à la communauté et en faisant son chef-d’œuvre en présence des jurés, on devenait maître. Une des clauses les plus importantes de ces statuts de 1489 fut sans contredit celle qui obligeait les brasseurs à marquer leurs barils. Chaque brasseur devait avoir sa marque, dont le modèle en plomb était déposé à la chambre des procureurs du roi, avec les marques des autres métiers. Les jurés étaient investis d’un droit de visite sur les bières apportées du dehors pour être vendues à Paris, les « bières foraines », suivant l’expression du temps ; les boissons qui étaient trouvées de qualité inférieure étaient saisies et sans autre forme de procès jetées à la rivière.
De nouveaux statuts furent rédigés ou confirmés en 1514, en 1630, en 1687 ; ces statuts firent défense expresse de brasser le dimanche, les jours de fêtes solennelles et de fêtes Notre-Dame.
Vers le milieu du dix-septième siècle, la rumeur publique prétendit que la levure de bière que les brasseurs vendaient aux boulangers était mauvaise et empoisonnait le pain. L’autorité s’émut et soumit le cas à la Faculté de médecine. Finalement, la communauté des brasseurs sortit victorieuse du procès fait à sa marchandise, et continua à avoir le monopole de la vente de la levure aux boulangers et aux pâtissiers. Les levures foraines apportées à Paris pour le même motif durent être soumises à l’examen des jurés de la corporation, qui était absolument maîtresse de ce commerce.
En temps de disette extrême, on pouvait défendre de brasser : c’est ce qui eut lieu en 1693, année où le blé coûta jusqu’à trente-deux livres le setier. D’ailleurs, même en temps ordinaire, on ne pouvait faire par jour dans chaque brasserie qu’un brassin de quinze setiers de farine au plus. Il va sans dire que cette défense n’était guère respectée, bien que les peines à encourir pussent être graves ; car, la bière étant soumise à des droits, le brasseur devait, à chaque brassin, avertir le commis de la perception de l’heure et du jour où il mettait le feu sous la chaudière, à peine d’amende et de confiscation. Ce n’était donc qu’en fraudant les droits du roi qu’on pouvait fabriquer plus que la quantité prescrite, et le fisc n’entendait pas raillerie en cette matière.
Voici quelle était à peu près l’organisation de la corporation des brasseurs à la fin du dix-huitième siècle. Elle était dirigée par trois jurés ou gardes, dont deux se changeaient de deux en deux ans. L’apprentissage durait cinq années, et en outre, avant de passer maître, il fallait être trois ans compagnon et faire ensuite un chef-d’œuvre. Chaque maître ne pouvait avoir qu’un seul apprenti ; s’il en avait deux, l’un devait commencer sa première année quand l’autre entrait dans sa cinquième. Les fils de maître avaient le privilège d’ouvrir boutique en faisant simplement le chef-d’œuvre en présence des jurés, privilège qui leur donnait ainsi huit ans d’avance sur les confrères.
Les brasseurs peuvent s’enorgueillir d’avoir compté parmi eux plus d’une illustration ; mais aucun d’eux à coup sûr n’a surpassé en renommée le brasseur de Gand, Jacques d’Artevelde. Fils d’un chevalier flamand, il avait beaucoup voyagé, puis s’était fixé à Gand. Fort ambitieux, et comprenant qu’en Flandre tout le pouvoir était aux mains des métiers, il s’était fait brasseur ; il devint successivement doyen de son corps d’état, puis des cinquante et un métiers de Gand. On sait le rôle qu’il joua au début de la guerre de Cent ans et l’immense influence qu’il sut acquérir sur les villes flamandes ; mais il ne faut pas oublier que son règne, car il fut aussi puissant qu’un roi, fut de courte durée et que son ambition lui coûta la vie.
Bûcherons du temps jadis : une existence « au fil du bois »
(D’après « Le Nouvelliste illustré », paru en 1900)
En 1900, Jules Jeannin, professeur de trait — on désigne ainsi les opérations de tracé des épures et de lignage des bois afin de mettre en œuvre des charpentes traditionnelles —, entrepreneur de Menuiserie, d’Art et de Bâtiment, membre du Comité technique de la Société de protection des apprentis et co-auteur deux ans plus tôt d’un Traité de menuiserie en trois tomes, publie au sein du Nouvelliste illustré un récit ayant trait à cette vie des bûcherons du XIXe siècle que les mots âpreté, entraide, plaisirs simples et communion avec la nature, ne sauraient mieux qualifier
Depuis un mois déjà, ils partaient chaque matin, après avoir mangé la soupe à la chandelle, et, s’étant réunis aux Quatre-Chemins, ils montaient ensemble la colline, la hache sur l’épaule ou au bras, un sac de toile en bandoulière, et arrivaient à la pointe du jour sur la lisière du bois. Le sac contient généralement un morceau de pain, un bout de fromage de gruyère ou une poignée de noix. Quelquefois il y a noix et gruyère, et lorsque cela arrive, ce jour-là compte pour un heureux jour, mais les heureux jours sont rares pour les rudes bûcherons.
— Nous sommes tous pauvres, sans doute, nous mangeons maigre, disait le père Francis, mais nous sommes solides quand même et nous devenons vieux, et ce n’est pas ça qui nous empêche d’abattre les arbres.
Jamais aucun bûcheron ne porte à boire avec soi, car il y a une source dans la forêt, une belle source où les oiseaux vont boire, eux aussi. Aussitôt arrivés, ils suspendent leurs sacs à une branche d’arbre, bourrent leur pipe, les allument, ôtent leur blouse, et voilà que la forêt résonne sous les coups des haches ; celles-ci s’enfoncent, précipitées, dans le tronc des hêtres, projetant au loin de larges copeaux qui sifflent en passant avec des façons d’éclats d’obus. De temps à autre, l’on entend, dominateur de tout bruit, un formidable craquement aussitôt suivi d’un choc épouvantable : c’est un géant qui tombe, majestueux, comme devaient autrefois tomber, dans la bataille, les preux tout bardés de fer.

Bûcherons au XIXe siècle
J’aime ces hommes des bois pour leur endurance et leur sobriété, écrit Jules Jeannin, aussi parce qu’ils sont doux et bons entre eux ; car si quelqu’un n’a pas de fromage ou de noix, il en mange quand même. Si l’un ou l’autre n’a pas de pipe, manque de tabac, ce n’est pas cela qui l’empêchera de fumer. Aucun ne voudrait qu’il en fût autrement, tous sachant que s’entraider, se porter mutuellement secours est une des belles choses de la vie. Et je me souviens avec plaisir des refrains lentement chantés dans la nuit, lorsqu’ils s’en revenaient : refrains berceurs, roulades amoureuses ou rustiques. Car vous devez savoir que les aimables et rudes bûcherons ne quittent jamais la forêt avant que la nuit les en chasse. Tant qu’ils peuvent distinguer l’endroit où la hache doit frapper, ils frappent sans relâche.
Mais, comme les jours deviennent de plus en plus courts, et que les haches ont fait grand ouvrage, que chaque matin le chantier se trouve plus éloigné, ils ont décidé de coucher dorénavant dans les bois. Ne croyez pas que cela les attriste. Non. Du reste, la fatigue, pour eux, sera bien moins grande, et tout bûcheron aime à entendre, la nuit, en automne, en hiver, la plainte sonore des arbres géants tordus par les vents.
L’été, le roucoulement des colombes, perchées on ne sait où, est délicieux dans la solitude des forêts ; et la voix des hiboux, de ces si mystérieux amis de l’obscurité, s’appelant ou se répondant, n’est-elle pas admirable dans le silence de la terre ? Si vous ne l’aimez pas, la belle voix plaintive de ces incomparables noctambules, c’est que vous ne la comprenez point. Lorsque vous aurez le bonheur de l’entendre, écoutez bien, et je suis sûr que vous y trouverez l’harmonie et la profondeur que je sais ; car, vraiment, les trilles et les roulades du rossignol, cet autre soliste aimé des nuits, si beaux qu’ils soient, ne sont rien auprès d’elle. Le chant du rossignol va droit au cœur, oui, et superbement ; mais la voix des hiboux, c’est à l’âme qu’elle parle. Elle nous fait penser, la belle voix des hiboux, à ceux que nous avons perdus, que nous n’avons peut-être pas assez aimés ; elle nous dit qu’il faut devenir meilleurs, que nous devons être bons quand même, malgré tout.
Or, ils apportèrent donc, ce matin-là, avec leurs haches, des pioches, des pelles et des merlins, afin de construire leurs maisons. Aussi la forêt n’eut pas, de toute la journée, les échos des jours précédents, échos gais ou plaintifs, mais toujours évoqueurs de souvenirs. La terre ne trembla point à la chute d’un géant. Aucun renard ne fut dérangé de son terrier ; aucun sanglier ne se précipita épouvanté de sa bauge. De loin, la forêt, si pleine de vie hier encore, paraissait morte. En se rapprochant, mais vers le milieu seulement, au plus épais de la belle cinquantenaire, on n’entendait que le bruit vague des bûcherons qui bâtissaient. Sur le soir, comme la nuit allait bientôt venir, la nuit profonde des bois, douze habitations s’élevaient là, dans une superficie de cent mètres carrés à peine, où se voyaient encore des arbres le matin.
Vous le comprenez alors, rien de plus simple à construire qu’une maison de bûcherons. Du reste, dans la forêt, il y a tout ce qu’il faut pour cela : des arbres, des feuilles, de la terre, de la mousse et de l’eau, c’est plus que suffisant, si l’on ajoute, ensuite, des pierres, que l’on roule tout autour et au pied des maisons, une fois construites, pour les consolider, lorsqu’il n’a pas été possible d’utiliser des arbres non coupés, ce qui arrive assez rarement.
Toutes les habitations sont bâties sur le même modèle ; il n’y a que celle du maire qui est environ trois fois plus spacieuse que les autres, car c’est dans celle-là que les bûcherons se réunissent, le soir, se tassant l’un contre l’autre, pour jouer aux cartes ou aux dés, sur une pierre, à la lueur d’un feu toujours fait de branches mortes. L’enjeu ne dépasse jamais une pipe de tabac ou un verre de piquette, car ils boivent de la piquette, en soupant, quand ils couchent dans les bois ; mais il arrive que l’enjeu ne soit que d’un demi-verre ou d’une demi-pipe, car les bûcherons sont pauvres, vous le savez ; néanmoins, ils ne s’en plaignent pas trop, et ce n’est pas cela qui les « empêche d’abattre des arbres ». Quand la veillée est finie, chacun regagne sa hutte et se couche sur le tas de feuilles sèches, recouvert d’une toile d’emballage.
Deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, un panier au bras ou sur la tête, une cruche ou un bidon à la main, les femmes, les mères ou les sœurs des hommes des bois, leur portent leurs provisions. Dans la cruche ou le bidon, il y a toujours de la piquette ; dans le panier, il y a d’abord une miche de pain, puis des fruits, du fromage, du lard et des saucisses. Saucisses, lard et piquette sont pour le repas du soir et du matin, invariablement ; à midi, ils ne mangent que du pain et des fruits ; s’ils ont soif, ils vont boire à la source ; quand elle est trop éloignée, l’un d’eux va chercher de l’eau dans une cruche.
Tous les quinze jours ou toutes les trois semaines, les bûcherons rentrent au village, le dimanche, et font un brin la fête, mangent le bouilli, la soupe chaude, et boivent une chopine de vin ; l’après-midi, ils font des parties de quilles, pour se reposer. Et les voilà ainsi pour toute la campagne, cinq mois environ. Chaque année, ils font deux ou trois campagnes. Mais celle-ci est dure pour eux, car ils gagnent deux sous de moins, par jour, que dans toutes les précédentes, ayant été obligés de consentir à cette réduction, la commune étant pauvre, elle aussi, et cette coupe-là devant être vendue pour la construction d’une école ; or, ils n’ont pas voulu attendre plus longtemps d’en avoir une, eux, les fiers et rudes abatteurs d’arbres, afin que leurs enfants, ou leurs frères et sœurs ne fassent plus, surtout l’hiver, près de quatre kilomètres de chemin, dans des sentiers impossibles, pour aller apprendre à lire et à compter.
Brodeurs
(D’après un article paru au XIXe siècle)
Il n’est peut-être pas de métier dont l’histoire, en Occident surtout, ait été plus intimement liée à celle de la peinture. Si la broderie est tombée en décadence de nos jours, et même dès la fin du seizième siècle, il ne faut pas oublier que, pendant longtemps, les peintres furent les auxiliaires des brodeurs : ceux-ci peignaient avec leurs aiguilles les compositions que les peintres avaient d’abord ébauchées au moyen de leurs pinceaux et dont ils avaient fait les cartons.
C’était un métier difficile. « Dans tout le moyen âge, dit de Laborde, et jusqu’à la fin du seizième siècle, broder était un art, une branche sérieuse, estimable, de la peinture. L’aiguille, véritable pinceau, se promenait sur la toile et laissait derrière elle le fil teint en guise de couleur, produisant une peinture d’un ton soyeux et d’une touche ingénieuse. »
S’il faut en croire les chansons
de gestes, on faisait même des
portraits brodés :
… La mescine
Ouvroit ès cambre la roine
Un confanon avoec le roi,
U el paignoit et lui et soi,
dit le roman de Flore et Blanceflor. Dans plus d’un inventaire de trésor du moyen âge se trouvent mentionnés des portraits en broderie.
La broderie semble être toujours
demeurée le passe-temps des grandes :
Catherine de Médicis brodait, et Ronsard,
dans son ode à la reine de Navarre, lui dit,
en parlant de Minerve :
Elle addonoit son courage
A faire maint bel ouvrage
Dessur la toile, et encor
A joindre la soye et l’or.
Vous, d’un pareil exercice,
Mariez par artifice
Dessur la toile en maint trait
L’or et la soye en pourtrait.
Il est à peine utile de rappeler que la fameuse tapisserie de Bayeux, qui représente les hauts faits de Guillaume le Conquérant , passe pour être l’ouvrage de la reine Mathilde ; et, bien que le fait ne soit pas absolument prouvé, il n’y aurait pas lieu d’en être surpris.
Il serait trop long d’énumérer les spécimens de broderies qui sont parvenus jusqu’à nous. Citons en première ligne les ornements épiscopaux de Thomas Becket, conservés aujourd’hui à la cathédrale de Sens, et que la gravure a souvent reproduits ; mentionnons encore les ornements de la chapelle de Charles le Téméraire, aujourd’hui à Berne.
Au dix-septième siècle, Alexandre Paynet, brodeur du roi Louis XIII, exécuta de magnifiques ornements que ce prince avait l’intention d’offrir au saint sépulcre de Jérusalem. Mais ce serait une grande entreprise que de vouloir indiquer tous les fragments d’étoffes brodées qui se trouvent encore aujourd’hui soit dans les trésors des églises, soit dans les bibliothèques, où souvent ils ont servi de couverture à des manuscrits.
La corporation des brodeurs et brodeuses reçut d’Etienne Boileau ses premiers statuts vers la fin du treizième siècle, en même temps que celle des « faiseuses d’aumosnières sarrazinoises », dont le métier ne différait qu’en ce qu’il s’appliquait à de plus petits objets. Dans ces statuts, on énumère les brodeurs et brodeuses qui se trouvaient alors à Paris, et il est à remarquer que plusieurs de ces dernières avaient pour maris des enlumineurs : on observe le même fait en 1316, date à laquelle la corporation eut de nouveaux statuts. Cette association d’enlumineurs et de brodeuses ne fut pas sans doute fortuite, et on peut croire que ces deux métiers ne pouvaient guère subsister l’un sans l’autre, le peintre créant les motifs que la brodeuse exécutait ensuite avec l’aiguille.
En Italie, de grands peintres ne dédaignèrent pas de faire des cartons pour des broderies : Antonio Pollajolo dessina pour Saint-Jean de Florence des ornements magnifiques, qui furent exécutés par des brodeuses ; bien d’autres s’associèrent à de semblables travaux.

Les règlements qui régissaient le métier des brodeurs à l’époque d’Etienne Boileau n’étaient pas fort nombreux ; ils concernaient les conditions d’apprentissage et la direction de la corporation par quatre prud’hommes ; quelques dispositions, enfin, déterminaient quand et comment on devait travailler : « Nuls ne nule ne pourra ouvrer ou dit mestier de nuiz fors tant come la lueur du jour durra tant seulement ; car l’œuvre fete de nuiz ne peut estre si bone ne si souffisante come l’œuvre fete de jour. »
L’apprentissage durait huit ans, et chaque maître ou maîtresse ne pouvait avoir qu’un apprenti ou une « apprentice » à la fois. Ce long apprentissage assurait la transmission d’ouvrier en ouvrier de tous les procédés de l’art. Les statuts des « faiseuses d’aumosnières sarrazinoises » étaient à peu près semblables.
Le métier se maintint très florissant jusqu’au dix-septième siècle ; puis vinrent plusieurs ordonnances qui défendirent l’abus des broderies et des ornements d’or dans le costume, et force fut aux brodeurs-chasubliers (c’est le nom que leur donnent les statuts de 1648) de se consacrer presque exclusivement à la confection des chasubles et des autres ornements religieux. A part ces travaux, on ne broda plus guère que des étoffes légères ; on employa plus rarement la soie et l’or.
Le nombre des maîtres fut limité à douze cents par les statuts de 1648 ; mais cette disposition ne fut jamais rigoureusement observée, bien que le nombre dût être forcément assez restreint, puisqu’on n’admettait à l’apprentissage que des fils de maître ou de compagnon et que chaque maître ne pouvait avoir qu’un apprenti. L’apprentissage durait six ans, et l’on n’était reçu maître qu’à condition d’ouvrir boutique et qu’après avoir été compagnon pendant trois ans. Le chef-d’œuvre, apprécié par les jurés visiteurs, était obligatoire ; seuls, les fils de maître étaient exempts de quelques-unes de ces formalités. On ne pouvait parvenir à la maîtrise avant l’âge de vingt ans.
Aucun maître ne pouvait s’associer avec un compagnon. Distingués en jeunes, modernes ou anciens, suivant qu’ils comptaient dix, vingt ou trente ans de réception, les maîtres devaient assister, au moins au nombre de trente, aux assemblées générales pour que les délibérations fussent valables.
Dans leurs broderies, les ouvriers du dix-septième et du dix-huitième siècle, cherchaient surtout à imiter les dentelles les plus renommées, telles que le point de Hongrie et la dentelle de Saxe. Exécutée tantôt à la main, tantôt au métier, la première, d’une exécution plus longue et plus difficile, fut toujours préférée.
Voici les termes qui, au dix-huitième siècle, désignaient les genres de broderie les plus usités :
broderie « à deux endroits » ou broderie « passée », travail qui produisait un dessin exactement semblable sur les deux faces de l’étoffe
broderie « appliquée », exécutée sur de la grosse toile, que l’on découpait ensuite pour la coudre sur une autre étoffe
broderie « en couchure » ou broderie d’or et d’argent : les mêmes matières servaient aussi à la broderie « en guipure » ; mais, pour exécuter celle-ci, on commençait par dessiner sur l’étoffe même, puis on découpait du vélin en suivant les formes du dessin, et l’on cousait ensuite par-dessus l’or avec de la soie
broderie « plate », garnie de paillettes, et broderie en chenilles de soie, usitée surtout pour les ornements sacerdotaux.
Tels étaient les principaux genres de broderies que l’on exécutait lors de la suppression de la corporation. Si, au point de vue des procédés et de l’habileté de la main-d’œuvre, les brodeurs avaient fait des progrès, un examen même peu attentif de leurs productions montre dans quel état d’infériorité ils se trouvaient vis-à-vis de leurs prédécesseurs : la broderie n’était plus un art, mais un métier.
Chapeliers dans l’ancienne France
(D’après « Le Magasin pittoresque », paru en 1880)
Le métier de chapelier se divisait au Moyen Age en plusieurs branches. Il y avait les chapeliers « de fleurs », les chapeliers « de coton », les chapeliers « de paon », les « faiseuses de chapeaux d’orfrois », et enfin les chapeliers « de feutre », qui finirent par se substituer à tous les autres chapeliers.
Dans le haut Moyen Age, le terme chapeau s’entendait aussi bien d’une couronne de métal ou de fleurs que du véritable couvre-chef, et l’usage du chapeau-couronne semble remonter fort loin : quelques auteurs en ont attribué l’invention aux gaulois. Sans rien affirmer à cet égard, disons seulement que la mode en persista très longtemps au Moyen Age : comme on portait les cheveux très longs, il fallait les retenir et les empêcher de tomber sur les yeux. A chaque page de la littérature du Moyen Age nous rencontrons le « chapel de fleurs » ; les dames des romans et des chansons de gestes passent leur temps à en tresser…
Je n’ay cure de nul esmay,
Je veuil cueillir la rose en may
Et porter chappeaux de flourettes.
Les Chapeaux de fleurs furent plus tard remplacés dans la classe riche par des cercles d’orfèvrerie ornés de perles précieuses. Toutefois le « chapel de fleurs » resta à titre de redevance féodale, et fut considéré comme une marque d’honneur et de respect. A la fin du quinzième siècle, les dames de Naples offrirent à Charles VIII, à son entrée dans leur ville, une couronne de violettes.

Jeton de la corporation des chapeliers de la ville de Lyon
au XVIIe siècle (Musée de la Monnaie)
Les chapeaux de paon et d’orfrois ne furent portés que par les femmes. Sans doute les plumes de paon étaient alors plus coûteuses qu’elles ne le sont aujourd’hui, bien que le noble oiseau figurât souvent sur la table des grands seigneurs. Quoi qu’il en soit, c’était un ornement réservé aux grandes dames, qui s’en servaient pour décorer les coiffures compliquées dont elles s’affublèrent au quatorzième siècle et surtout au quinzième siècle.
Quant aux chapeliers de coton, il ne vendaient pas à vrai dire de chapeaux, mais des bonnets et des gants de laine.
Les premiers statuts des chapeliers de feutre et ceux d’une corporation qui n’était pour ainsi dire qu’une dépendance de leur métier, celle des fourreurs de chapeaux, datent à Paris d’Etienne Boileau, c’est-à-dire de la fin du règne de Saint-Louis ; ils furent plusieurs fois modifiés ou confirmés, notamment en 1324, 1325, 1367 et 1381.
D’après les plus anciens statuts, le maître chapelier ne pouvait avoir qu’un seul apprenti. L’apprentissage durait sept ans pour ceux qui n’étaient ni fils ni parents de maître ; il était gratuit, si le maître y consentait ; mais dans tous les cas il fallait verser dix sous à la caisse de la confrérie.
Deux prud’hommes nommés par le prévôt de Paris étaient chargés de veiller à l’exécution des règlements, qui, du reste, n’étaient ni très nombreux, ni très compliqués. Défense de faire entrer dans la confection du feutre autre chose que du poil d’agneau ; défense de vendre de vieux chapeaux reteints, d’ouvrir boutique le dimanche, et de travailler avant le jour : telles étaient les principales dispositions des statuts.
Ceux des fourreurs de chapeaux étaient à peu près semblables. Cependant chaque maître pouvait avoir deux apprentis qui, au bout de cinq années, devenaient compagnons ; se qui s’explique facilement, si l’on songe que leur métier était beaucoup moins compliqué que celui des véritables chapeliers : ils n’avaient qu’à garnir les chapeaux qu’on leur apportait tout préparés. Ce qu’on leur recommande plus particulièrement dans les statuts , c’est que la fourrure des chapeaux soit aussi bonne en dedans qu’en dehors : « Ou tout viez ou tout nuef », ajoute la rédaction de 1325. Toutes les marchandises fabriquées contrairement aux règlements devaient être brûlées.
Dans certaines villes, à Rouen, par exemple, les chapeliers réunissaient plusieurs industries : ils s’appelaient chapeliers-aumussiers-bonnetiers. Ils avaient fondé la confrérie de Saint-Sever dans l’église Notre-Dame de Rouen, comme ceux de Paris fondèrent celle de Saint-Jacques et de Saint-Philippe dans l’église des Jacobins de la rue Saint-Jacques ; mais, par une singulière disposition, tous les chapeliers n’étaient point forcés d’entrer dans la confrérie.
Autre singularité : les apprentis ne passaient leur contrat d’apprentissage qu’après quinze jours d’essai, pendant lesquels ils jugeaient si le métier leur agréait ; le maître profitait aussi de ce délai pour apprécier si son nouvel apprenti pouvait lui convenir et s’il devait le conserver.
On a vu qu’il était défendu aux chapeliers de faire du feutre avec autre chose que du poil d’agneau. Plus tard, les choses changèrent beaucoup. Dès le quatorzième siècle on se servait de castor et quelquefois de laine. Avec le temps on usa de poil de lapin, et même, au dix-huitième siècle, de poil de chameau ; le poil de lièvre demeura seul proscrit comme impropre à la fabrication d’un feutre convenable ; mais on l’employa quand même, grâce au procédé de la « dorure », qui consistait à y ajouter une petite quantité de poil de castor qui donnait aux chapeaux une bonne apparence, des plus trompeuses, du reste.

Ces modifications dans la fabrication se produisirent à mesure que l’usage des chapeaux se répandit. Encore rares au onzième siècle (ce ne sont guère que des espèce de calottes), ils deviennent très fréquents au douzième siècle et au treizième siècle : à cette époque même, des chapeaux, presque toujours pointus et de couleur jaune, deviennent parfois le signe distinctif imposé aux juifs. Mais ce n’est qu’au quatorzième siècle, où le chaperon est à peu près complètement abandonné, que l’usage du chapeau devient général. Enumérer tous les couvre-chef qui ont été de mise depuis cette époque serait fort long : chapeaux ronds et bas de forme, pointus, à larges bords, à trois cornes, se sont succédé sans que la mode se soit fixée définitivement.
Certaines particularités sont à rappeler au sujet de la réception du compagnon. Les maîtres et les compagnons formaient une sorte de société dont ils s’engageaient par serment à ne jamais dévoiler les secrets ; en y entrant ils recevaient le titre de « compagnons du devoir. » Le tout était accompagné de cérémonies bizarres, sorte de parodie de la messe, d’une messe noire ou d’une messe du diable, comme on disait alors. Cette singulière coutume dura jusqu’en 1655 ; à cette époque la Sorbonne s’émut, et toutes les diableries des chapeliers, dévoilées sans doute par un faux compagnon, durent cesser à peine de punition exemplaire.
Des artisans copistes aux imprimeurs
(D’après « Bulletin de la Société historique de Compiègne », paru en 1899)
Jusqu’à la fin du XVe siècle les manifestations de la pensée n’étaient reproduites que par des copies manuscrites. Longtemps confiées aux moines et aux clercs des diverses abbayes, ces sortes de travaux furent entrepris plus tard par des laïques qui finirent par former l’importante corporation des maîtres écrivains enlumineurs, lesquels cherchèrent à entraver durant plus d’un siècle la progression d’une imprimerie menaçant la pérennité de leur activité et bientôt placée sous la plus étroite surveillance.
Au XIVe siècle, on comptait à Paris plusieurs milliers de copistes dont le plus grand nombre habitaient le quartier de la Cité, celui de la Tour-Saint-Jacques-la-Boucherie, et particulièrement la rue qui, à raison de leur présence, prit le nom de rue des Écrivains et qui disparut à l’époque du prolongement de la rue de Rivoli. La découverte de l’imprimerie, comme on peut le deviner, mit au désarroi cette pléiade d’artisans. Aussi cherchèrent-ils, par tous les moyens possibles, à entraver le développement de cette merveilleuse invention qui révolutionna le monde entier.
Ils allèrent jusqu’à lancer contre les imprimeurs l’accusation de sorcellerie. « On ne connaît pas, écrit Paul Sebillot dans Légendes et curiosités des métiers, le détail des griefs qu’ils formulèrent ; ils devaient différer assez peu de ceux qui étaient d’usage en semblable occurrence : pacte avec le diable, intervention des puissances surnaturelles. Selon Voltaire, qui ne cite pas la source de cette anecdote, ils avaient intenté un procès à Gering et à ses associés qu’ils traitaient de sorciers. Le Parlement commença par faire saisir et confisquer tous les livres. C’est alors que le roi intervint entre les persécutés et le tribunal persécuteur. Il lui fit défense, dit Voltaire, de connaître de cette affaire, l’évoqua à son Conseil, et lit payer aux Allemands le prix de leurs ouvrages. »
On sait que la typographie découverte en Allemagne vers 1436 ne fut réellement mise en usage à Paris qu’en 1470 et qu’à la fin du XVe siècle les grandes villes de France voyaient s’installer des imprimeries dans leurs murs, mais il ne dut pas en être de même dans les localités bien moins importantes : aussi ne faut-il pas s’étonner de ne rencontrer aucune trace d’impressions locales dans les petites villes de province avant la moitié du XVIe siècle.
Et cependant, il y a lieu de le reconnaître, ainsi qu’on l’a déjà vu plus haut, les rois de France n’avaient pas hésité, dès le principe, à encourager l’imprimerie et à en favoriser le développement. Charles VIII notamment délivrait en mars 1488 des lettres patentes portant concession de tous les privilèges de l’Université au profit des libraires et imprimeurs et autres suppôts de la dite Université, et vingt-cinq ans plus tard, Louis XII signait à Blois la fameuse déclaration du 9 avril 1513 dans laquelle, considérant l’invention de l’imprimerie comme « une œuvre divine plutôt qu’humaine », il octroyait à nouveau les mêmes privilèges aux libraires, imprimeurs, relieurs, illumineurs et écrivains jurés.
Après lui vinrent François Ier (1515-1516-1543), Henri II (1547) et Charles IX (1560) qui confirmèrent les grâces, faveurs, franchises, exemptions etc., dont jouissaient déjà ceux qui exerçaient ces mêmes industries. Au mois de novembre 1381, Henri III généralisa par un édit l’institution des maîtrises dans les arts et métiers, et ceux à qui incombait l’exécution de cette mesure élevèrent la prétention de l’appliquer aux imprimeurs et libraires qu’ils considéraient comme des artisans mécaniques ; mais ces derniers trouvant qu’une telle interprétation était attentatoire à l’honneur de l’imprimerie qui, à leurs yeux était un art véritable, en appelèrent au roi lui-même. Le Conseil d’État privé, saisi alors de la question, rendit le 30 avril 1583, un arrêt qui décida que l’édit de 1581, n’était pas applicable aux imprimeurs-libraires. A partir de ce jour, les privilèges en question ne soulevèrent plus de sérieuses contestations.
Le 28 février 1723, Louis XV édicta un règlement spécial sur le fait de la librairie et de l’imprimerie à Paris, mais comme, à la rigueur, ses dispositions ne s’imposaient pas d’une façon suffisante aux imprimeurs de province, il intervint, le 24 mars 1744, un nouvel arrêt du Conseil d’État, qui ordonna qu’elles seraient applicables dans toute l’étendue du royaume.
Le règlement du 28 février où l’exercice de l’imprimerie se trouve minutieusement analysé et qui a été, à juste titre, qualifié de Code de l’Imprimerie et de la Librairie est très intéressant à connaître, car, non seulement il dépeint ce qu’étaient il y a plusieurs siècles les imprimeurs et les libraires, mais encore il reflète, mieux qu’on ne le pourrait faire, les mœurs et les idées du temps où il parut. Une analyse succincte des principaux passages suffira pour le démontrer.
Ce qui frappe d’abord, quand on parcourt ce document, c’est le soin avec lequel l’autorité royale entendait renfermer les imprimeurs et les libraires dans des limites pouvant lui permettre la plus grande surveillance. Ainsi l’article 4 défendait « à toutes personnes à quelque qualité et condition qu’elles fussent, autres que les libraires et imprimeurs de faire le commerce de livres, d’en vendre et débiter aucuns, de les faire afficher pour les vendre en leur nom, soit qu’ils s’en disent les auteurs ou autrement, ni de tenir boutique ou magasin de livres, d’acheter pour revendre en gros ou en détail, en chambres et autres lieux, même sous prétexte de vendre à l’encan aucuns livres en blanc (c’est à dire en feuilles) ou reliés, gros ou petits, neufs ou fripés, même de vieux papiers qu’on appelle à la rame et de vieux parchemins, à peine de cinq cents livres d’amende, de confiscation et de punition exemplaire ».
Déjà, bien auparavant, le Bailli du Palais avait, le 21 juillet 1668, rendu une sentence qui déclarait bonne et valable la saisie pratiquée chez un parfumeur, d’un Traité du Tabac dont il détenait plusieurs exemplaires, et le Parlement de Rouen, faisait en 1675, « inhibitions et défenses à tous collèges, communautés et maisons religieuses, d’avoir aucune imprimerie chez eux ou en une maison particulière, ni de vendre et débiter aucuns livres en blanc ou reliés que par les mains des libraires.
Plus tard, un arrêt du Conseil en date du 4 juin 1718 faisait défense à Jean-Baptiste Lully, le célèbre compositeur, surintendant de la musique du roi, d’afficher, vendre ou faire vendre ses propres opéras autrement que par un imprimeur ou par un libraire. Et sous l’empire du règlement de 1723, les époux Péron, marchands fripiers à Blois, qui avaient acheté à la criée quelques livres provenant de la bibliothèque de l’abbé Mesnage, prêtre habitué de la paroisse Saint-Honoré, se voyaient poursuivis et condamnés pour avoir mis à l’encan deux ou trois de ces mêmes livres.

Un enlumineur au XVIe siècle. Gravure de Jost Amman
Toutefois, il y avait exception à l’égard des marchands merciers-grossiers de la ville de Paris ; c’est ainsi qu’on désignait ceux qui faisaient le commerce en gros. L’article 5 du règlement les autorisait, en effet, ce qui s’est toujours continué, à vendre les A.B.C., Almanachs, petits livres d’heures et de prières imprimés hors la ville, pourvu qu’ils n’excédassent pas deux feuilles et qu’ils fussent du caractère Cicéro : c’est le nom qu’on donnait aux caractères d’imprimerie ayant onze points typographiques de force et de corps, semblables à ceux qui avaient servi en 1467 à Rome pour l’impression des Épîtres de Cicéron.
L’article 10 n’accordait également aucun privilège aux libraires et imprimeurs de Paris pour l’impression des Factums, Mémoires, Requêtes, Placets, Billets d’enterrement, Pardons, Indulgences et Monitoires. L’article 6 permettait aux femmes et veuves de compagnons imprimeurs ou libraires, d’acheter et de vendre les papiers à la rame et les vieux parchemins à l’usage des imprimeurs, libraires et relieurs. Aux termes de l’article 17, tous les imprimeurs étaient tenus d’employer de bons caractères et de beau papier, avec indication du nom du libraire qui avait commandé l’ouvrage, et, bien entendu, il était défendu d’indiquer un faux nom, sous peine de cinq cents livres d’amende.
En outre, il était interdit d’avoir plus d’une boutique à la fois, ni de faire aucun étalage portatif sur les ponts, quais, parapets et dans les maisons privilégiées. On voulait ainsi éviter, comme l’explique une ordonnance royale du 25 septembre 1742, la vente de toutes sortes d’écrits sur la religion, le Gouvernement de l’État, et contre la pureté des mœurs. Enfin, les imprimeurs étaient tenus, d’après l’article 12, à avoir leur boutique ou magasin dans le quartier de l’Université ; quant aux libraires simples, ils avaient le choix entre ce quartier et l’intérieur du Palais. C’est dans ce dernier endroit qu’était installé le fameux Claude Barbin, illustré par Boileau et dans le magasin duquel s’étaient donné rendez-vous Trissotin et Vadius pour vider leur querelle. Inutile de dire qu’aucune boutique ne devait être ouverte les fêtes et dimanches (art. 16) sous peine d’amende.
Des maîtres imprimeurs ou libraires, le règlement passe aux apprentis. Pour être admis en cette dernière qualité, il fallait (art. 20) être congru en langue latine et savoir lire le grec. Une fois admis, l’apprenti devait travailler chez le même maître au moins quatre années entières et consécutives (art. 21), temps pendant lequel il ne pouvait se marier. Par contre, chaque imprimeur ou libraire ne devait avoir qu’un seul apprenti à la fois. Cette mesure avait pour but de prévenir, dans l’intérêt de la Communauté, les abus pouvant résulter du nombre toujours croissant des aspirants à la maîtrise.
Après son stage terminé, l’apprenti devait servir encore un maître pendant trois ans en qualité de compagnon, et ne pouvait abandonner un travail sans l’avoir achevé, mais en revanche, le patron était forcé de le lui laisser finir, ou tout au moins, de lui en fournir un autre de même qualité (art. 32).
L’article 41 renfermait une disposition assez singulière, portant que les compagnons, ouvriers ou apprentis ne pourraient faire aucun festin ni banquet, soit pour entrée ou issue d’apprentissage, soit autrement. Il leur était également interdit d’organiser « aucune communauté, confrairie, assemblée, cabale ni bourse commune », ou d’agir en nom collectif pour quelque cause et occasion que ce soit, à peine de prison, de punition corporelle et de trois cents livres d’amende (art. 42).
On était loin alors des grèves et des syndicats ouvriers. De plus, les apprentis ne pouvaient aller en troupe, tant de jour que de nuit, ni porter épées, poignards, bâtons et autres armes offensives, ni faire aucun tric. On appelait ainsi une sorte de signal convenu d’avance pour quitter le travail et se rendre au cabaret.

Une imprimerie à la fin du XVIe siècle
Après avoir déterminé les obligations imposées aux maîtres-imprimeurs et à leurs apprentis, le règlement énonçait les conditions pour arriver à la maîtrise : production de certificats de capacité, de bonne vie et mœurs et de catholicité ; examen à subir devant huit membres de la communauté ; serment à prêter entre les mains du lieutenant général de police : telles étaient les principales prescriptions. En outre, l’aspirant à la maîtrise de libraire simple versait au syndic une somme de mille livres ; celui qui voulait être tout à la fois imprimeur et libraire, était taxé à quinze cents livres (art. 45).
Dès qu’il était reçu à Paris, le candidat pouvait s’établir dans tout le royaume, sans subir de nouvelles épreuves. Ici se place l’article 49 qui intéresse la province et spécialement les villes du département de l’Oise. Cet article, en effet, consacrait, entre autres choses, un arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 1704, qui déterminait les villes du royaume dans lesquelles il était nécessaire qu’il y eût des imprimeurs-libraires pour le bien du service du roi et l’utilité du public, mais il en fixait le nombre dans chaque localité, parce que, disait-il, « il serait dangereux qu’il s’en établît un trop grand nombre, de crainte que ne trouvant pas assez d’ouvrage pour pouvoir subsister, ils ne s’appliquassent à des contrefaçons ou à d’autres impressions contraires au bon ordre. »
En conséquence, il n’était attribué qu’un seul imprimeur-libraire à Beauvais, Compiègne, Noyon et Senlis, avec cette condition que les places des imprimeurs qui viendraient à décéder seraient remplies par leurs veuves, tant qu’elles continueraient a exercer l’imprimerie, mais avec défense de prendre aucun apprenti.
Pourquoi cette interdiction ? Le texte est muet à cet égard. Craignait-on qu’une veuve, jeune encore, ne traitât avec trop de sollicitude l’apprenti qui devait vivre sous le même toit qu’elle, ou bien n’était-ce pas plutôt pour éviter d’augmenter ainsi le nombre des aspirants à la maîtrise ? Nous ne le saurions dire.
L’article 56 contenait une disposition relative aux correcteurs. Ces derniers devaient être capables, et si, par leur faute, il y avait nécessité de réimprimer les feuilles qu’ils avaient dû corriger, c’était à leurs frais. Enfin, ce qui s’explique de soi-même, il était formellement prohibé d’imprimer, vendre, exposer, distribuer ou colporter des livres ou libelles contre la religion, le service du roi, le bien de l’État, la pureté des mœurs, l’honneur et la réputation des familles et des particuliers ; et, en cas d’infraction, les imprimeurs et les libraires étaient punis, suivant la rigueur des ordonnances, privés et déchus de leurs privilèges et immunités, et déclarés incapables d’exercer à l’avenir leur profession, sans pouvoir y être jamais rétablis.
Tel fut le célèbre règlement concernant l’imprimerie et la librairie dont certaines dispositions s’appliquaient encore lorsque le décret du 10 septembre 1870 proclama la liberté de ces deux branches d’industrie et de commerce.
Epiciers d’autrefois
(Extrait de « Histoire anecdotique des métiers », paru en 1892)
Tantôt le nom d’épicier s’appliquait aux simples chandeliers ou fabricants de bougie, tantôt il s’étendait à cette classe intermédiaire entre les empiriques et les médecins, qu’on appelait les apothicaires. Rarement signifiait-il, au Moyen Age, le marchand de menus comestibles comme nous le comprenons de nos jours.
Nous retrouvons les épiciers fabriquant la bougie dans une ordonnance de 1312, où il leur est formellement enjoint de vendre de la bougie sans suif, à peine de confiscation de la marchandise. Ils doivent aussi se servir de balances justes et ne point tricher sur les poids. Nul ne pouvait peser les marchandises en gros s’il faisait lui-même commerce d’épicerie ; de même il était interdit aux courtiers de vendre pour leur compte les produits qu’ils étaient chargés de placer. Cette ordonnance un peu sévère s’étendit aux épiciers courant les foires de Champagne, par mandement spécial du roi.

Une boutique d’épicier au Moyen Age
Quelques années plus tard, nous les retrouvons, mêlés aux apothicaires dont ils suivront le sort pendant deux cents ans. En 1336, le prévôt de Paris rappelait aux apothicaires-épiciers qu’ils étaient forcés de soumettre aux maîtres de la médecine tous opiats ou autres drogues débitées dans leurs officines. On alla plus loin sous le roi Jean, et on prit ces marchands par leur côté honnête, ce qui était un peu simple pour le temps : on prétendit obtenir qu’ils ne falsifiassent point leurs marchandises, en réclamant d’eux un serment solennel ; l’histoire ne dit pas ce qu’il advint de cette mesure singulièrement naïve.
En 1450, voici à nouveau les maîtres épiciers devant la cour du prévôt. Cette fois ils sont censés réclamer un règlement de fabrication et de vente, et là encore nous retrouvons les anciens épiciers-chandeliers du XIVe siècle représentés par leurs maîtres Jean Chevart, Guillaume dit de Paris, Colin Laurens, Jean Bachelier et Jean Asselin. Le règlement qu’ils obtiennent porte sur la fabrication des bougies ou cierges et la vente des « saulces ou espicerie » qu’ils débitaient dans leurs « ouvroirs ». La bougie doit être faite moyennant dix bougies à l’once à peine de confiscation ; le fabricant devait de plus y imprimer sa marque personnelle préalablement déposée au bureau des jurés et chez le prévôt, pour qu’il fût très facile de retrouver les délinquants en cas de fraude.
Les épiciers tenant et vendant « saulces, comme canneline, saulce vert, saulce rapée, saulce chaude, saulce à composte, moustarde et aultres saulces », devront les composer de bonne qualité à peine de 10 sols d’amende, suivant les ordonnances « du mestier des saulces ». Les épiciers forains devaient faire visiter leurs marchandises par les jurés avant que de les mettre en étal. Ceux-ci étaient tenus de déférer à cette invitation d’examen dans la journée du lendemain au plus tard. Quant aux épiciers établis dans les villes, ils ne pouvaient rien acheter aux forains avant la visite des jurés.
Ces précautions, on est bien obligé de le reconnaître, avaient du bon, puisque l’ordonnance de 1450 régla longtemps le commerce d’épicerie chez nos pères, à des époques où, toute proportion gardée, la sophistication des denrées alimentaires ne laissait pas que de se faire aussi communément que de nos jours.
Il n’est point sans intérêt de rappeler ici que vers le milieu du XIVe siècle, grâce au négoce avec les pays du Levant, les épiciers se fournissaient plus facilement de drogues et produits levantins dont la mode s’empara. Il fut alors de bon ton de s’offrir réciproquement des « espices ou drogues » en cadeau, et il arriva souvent que pour hâter les juges somnolents, le client riche recourut à ces « blandices ».
Les magistrats acceptèrent d’abord timidement, puis ouvertement, si bien qu’en moins d’un demi-siècle les épices se payaient couramment en toutes causes. En 1483, les choses en étaient arrivées à un tel point que tout le monde des plaideurs réclamait à grands cris une taxe qui limitât un peu les extorsions des juges. Alors le nom seul était demeuré, mais les épices s’étaient changées en bons deniers comptants. De là le nom qui jusqu’en 1789 servit à désigner ce que nous appellerions volontiers le casuel des magistrats ; ce casuel avait été aboli au XVIe siècle ; mais, ayant reparu, on le régla en 1669, en faisant taxer les épices d’une cause par le président qui la jugeait.
Pour revenir aux épiciers, cause innocente de ces abus de justice, nous franchirons quarante années et nous les retrouverons, en 1514, aux prises avec les apothicaires. Ces derniers ayant fait quelque progrès dans « leur art », comme ils appelaient leur métier, réclamaient hautement leur séparation d’avec les épiciers, qui n’avaient ni leurs goûts ni leur science. « Car, qui est espicier n’est pas apothicaire, et qui est apothicaire est espicier » assuraient-ils, avec une certaine apparence de logique. Le roi écouta favorablement cet argument péremptoire, et les « espiciers simples », c’est-à-dire les marchands de « bougie de saulces et d’huile », eurent une existence à part.
Ce n’est pas que cette condition fût très brillante. Dans la plupart des cas, l’épicier du XVIe siècle courait les rues, offrant de ses denrées aux passants et heurtant aux portes des ménagères. Le nombre des épiciers tenant ouvroir était relativement restreint. Et puis, cette situation précaire, qui les forçait à empiéter toujours sur les métiers voisins, les plongeait dans la déconsidération. En 1620, ils obtinrent de vendre du fer forgé, des clous, et même du charbon, mais non sans provoquer des récriminations et des colères.
Le XVIIIe siècle les rattacha aux droguistes ou apothicaires. Ils vendent alors de la thériaque, des préparations de kermès, le mithridate, mais ils ne confectionnent pas ; un arrêt de 1764 leur prohibe essentiellement la manipulation et le mélange des drogues. Entre temps ils trouvent le moyen d’empiéter sur les charcutiers par la vente des jambons de Bayonne, de Bordeaux ou de Mayence.
Ils obtiennent contre les vinaigriers le droit de tenir jusqu’à trente pintes de vinaigre, mais sans parvenir à donner à leur infime métier l’ombre du prestige des autres corporations. Pourtant n’était point épicier qui voulait sous l’ancien régime ; et les conditions exigées chez l’apprenti étaient des plus sérieuses. Il fallait d’abord être Français, reconnu honnête, avoir compagnonné trois ans, après quoi les maîtres présentaient le candidat au procureur du roi.
Après le serment prêté devant le magistrat, les trois gardes de l’épicerie signaient le diplôme de réception qui devenait brevet de maîtrise. Toutes ces formalités donnaient au nouvel adepte droit de vendre où bon lui semblait drogues et épiceries, mercerie, clouterie, charcuterie et vinaigrerie, c’est-à-dire de vivre un peu aux dépens de tout le monde, de gratter sur tout, sans art et sans talent. Ainsi naquit ce type étrange si ridiculisé depuis, souffre-douleur des rapines et des étudiants.
Un métier oublié : le faiseur de bas de soie
Lorsque l’on évoque les métiers de la soie, on pense immédiatement aux tisserands, aux filateurs mais on oublie ces artisans qui pendant deux siècles confectionnèrent sur des métiers à bras cet accessoire indispensable de l’élégance tant masculine que féminine que fut le bas de soie.
Une vieille technique
Le travail de la soie est attesté dans les Cévennes depuis 1234, date du premier document mentionnant une activité séricole en France. On y signale l’exportation vers Marseille d’ouvrages en soie provenant des Cévennes. Le fait qu’un « trahandier », c’est à dire un dévideur de cocons, exerce son activité à Anduze, près d’Alès, en 1296, laisse supposer que le vers à soie, importé d’Italie, y était élevé sur place dès cette époque. Pendant plusieurs siècles, les Cévennes restent le centre de la sériciculture française jusqu’à ce que, sur les conseils d’Olivier de Serres, Henri IV fasse planter des mûriers dans la plupart des régions de France (les feuilles de mûrier sont la nourriture exclusive du vers à soie).
S’il est difficile de dater exactement l’apparition du bas de soie, on sait que dans la première moitié du XVIe siècle il fut fort prisé et son port encouragé par François 1er. Il s’agissait alors de bas faits en tissu de soie et ajustés. C’est entre 1540 et 1570 qu’à la suite de l’évolution du costume masculin, on vit apparaître des bas plus longs s’attachant aux chausses et tricotés, la maille donnant plus de souplesse et d’élasticité. Cette mode des bas de soie, exécutés aux aiguilles par des ouvriers spécialisés, se répandit rapidement dans tout le royaume.
L’apparition du métier à faire les bas
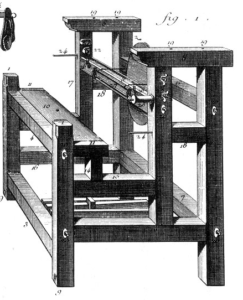
métier à faire des bas, 1763
Une seconde étape décisive pour le bas de soie fut l’invention du « métier à faire les bas ». Cette machine fut découverte vers 1610 par un anglais, Lee, qui s’installa à Rouen et commença une industrie florissante, soutenue par Henry IV et Sully. Mais à la mort de Lee, les ouvriers qui étaient anglais retournèrent dans leur pays avec les fameux métiers. A partir de ce moment, les anglais, jaloux de cette invention, défendirent alors « sous peine de vie, de la transporter hors de l’ile ni d’en donner modèle à un étranger ». Cependant, un français, Jean Hendret, réussit à surprendre le secret, fit construire le premier métier français et fonda en 1656, au château de Madrid au bois de Boulogne, la première manufacture de bas au métier.
Le succès remporté aboutit en juillet 1672 à la déclaration royale érigeant en titre de maîtrise et communauté « le métier et manufacture de bas, canons, camisoles, caleçons et autres ouvrages de soye qui se font au métier ». La fabrique de bas de soie se développa de façon fulgurante. Mais dès 1700 un arrêté va considérablement restreindre la liberté d’exercice du métier : « Défense d’établir aucun métier ailleurs qu’à Paris, Dourdan, Rouen, Caen, Nantes, Oléron, Aix, Toulouse, Nîmes, Uzès, Romans, Lyon, Metz, Bourges, Poitiers, Orléans, Amiens et Reims. Tous les faiseurs de bas établis dans une autre place doivent se retirer dans les dites villes ». Défense de travailler ou de faire travailler sans avoir été reçu maître. Obligation pour les compagnons de se faire reconnaître par les jurés de leur communauté et de se faire inscrire sur un registre avec mention de leur demeure et du nom de leur maître. Interdiction pour eux de vendre un ouvrage fait au métier. Interdiction aux femmes et aux filles de travailler au métier, exception faite pour les filles de maître mais seulement dans l’atelier de leur père. D’autres points des statuts portent sur la taille des métiers, la qualité de la soie à employer, la précision du travail.
Cette réglementation satisfaisait les fabricants de bas proprement dits qui voulaient se réserver le monopole du métier, mais les facturiers de laine, les marchands de drap et de soie qui prétendaient faire travailler et vendre des bas pour leur compte contestaient ces dispositions. Des conflits entre les deux communautés vont s’installer jusqu’en 1712.
A partir de 1713, le monopole des dix-huit villes étant difficile à respecter, on permit à des habitants d’autres lieux d’exercer le métier. Ce qui ne manqua pas de soulever des difficultés.
Au-delà de ces querelles, la principale préoccupation fut de satisfaire la demande et d’adapter la production aux besoins et aux goûts de la clientèle. Les bas fabriqués à Paris et consommés dans la capitale étaient considérés comme très solides tandis que ceux de Nîmes avaient la réputation d’être moins résistants, la nécessité de faire des produits bon marché influant sur la qualité. En effet, la production cévenole était destinée non seulement à la consommation intérieure mais surtout à l’exportation, principalement à l’Espagne et aux Indes espagnoles. Ainsi en 1760 la ville de Lima, au Pérou, consommait deux millions de bas de soie par an. Pour plaire à cette clientèle, les faiseurs de bas avaient reproduit sur leur fabrication les broderies et les couleurs des bas de coton que les péruviennes avaient l’habitude de porter.
Le métier proprement dit
Quels qu’aient été les statuts de la corporation, la trajectoire à suivre pour devenir faiseur de bas reste la même :
Trois années d’apprentissage chez un maître ou chez un fabricant inscrit au registre de la communauté. L’artisan s’engage, par contrat passé devant notaire, à transmettre au jeune homme tout ce qui est nécessaire pour apprendre le métier, en retour l’apprenti s’engage à faire tout son possible pour y parvenir.
Deux années de compagnonnage. Au terme de cette période, il pourra prétendre à la maîtrise (jusqu’en 1712) ou à être du corps (après 1712).
Soit la maîtrise : Le compagnon doit monter un métier devant le syndic et payer un droit d’inscription. Soit l’entrée dans le corps : le compagnon doit exécuter une paire de bas dont la qualité est jugée par les syndics et payer les frais de réception.
Le faiseur de bas travaille chez lui et peut avoir jusqu’à quatre métiers. Sa journée de travail est longue. A la fin du XVIIIe siècle, elle s’étendait en été de cinq heures du matin à la tombée de la nuit, en hiver de six heures du matin à dix ou onze heures du soir.
Il existe des bas pour hommes et des bas pour femmes. Ils peuvent être unis, ajourés ou brodés. Au sortir du métier, le bas se présente comme une bande plate à sinuosités symétriques. Le talon a été renforcé par doublement du fil. La pointe, aussi renforcée, est confectionnée à part. Les bas sont ensuite assemblés par des couturières spécialisées. Dans un premier temps elles rassemblent les deux moitiés des talons et des semelles et ajustent les pointes. Ensuite, elles plient les bas longitudinalement pour réaliser la couture, besogne délicate et toute en finesse. D’autres femmes interviennent, ce sont les brodeuses, la broderie étant un élément important de la commercialisation. Lorsqu’il est noir, le bas ne doit recevoir sa nuance qu’après complet achèvement au métier, sauf sil entre dans sa confection des fils d’or ou d’argent. Pour les autres teintes, c’est le fil de soie qui est préalablement teinté avec des colorants comme la cochenille, le safran, l’indigo, l’épine vinette, la gaude ou encore le bois des îles. Chaque douzaine de bas est marquée avec un plomb portant les noms de la ville et du fabricant avant d’être commercialisée.
Une classe privilégiée ?
Chaussé de sabots, coiffé d’un bonnet de coton, les mains fréquemment lavées pour ne pas salir un ouvrage si délicat, le faiseur de bas travaille souvent debout à la lumière du jour ou à la lueur d’une lampe associée à un globe de verre qui démultiplie la lumière. Il lui faut une journée entière pour réaliser une paire de bas. Le dimanche et le lundi sont chômés. Ce repos hebdomadaire est occupé à l’entretien du métier et aussi au travail des champs, lopin de terre ou carré de vigne, car l’artisan reste toujours un peu cultivateur.
La profession est très souvent héréditaire et le métier à faire les bas, portant le nom du premier utilisateur gravé sur la barre transversale, se transmet de génération en génération comme un meuble de famille. Il figure ainsi en bonne place dans les inventaires après décès. Cette classe d’artisans a toujours semblé assez privilégiée. En 1790, il est affirmé quelle est encore la plus aisée, la moins exposée aux maladies et celle qui se nourrit le mieux. En 1836, il est dit que le faiseur de bas est plus propre que les autres, plus économe, de meilleures mœurs et plus aisé malgré la modicité de ses gains.
La fabrique de bas à domicile va se maintenir tant bien que mal jusque vers 1880, date de l’apparition du métier mécanique mu par la vapeur. C’est la mort du métier à bras. Le savoir-faire si patiemment acquis pendant les années d’apprentissage et de compagnonnage n’est plus nécessaire. L’artisan ne peut plus travailler chez lui, en famille, libre de gérer son temps.
Le faiseur de bas abandonne son art pour l’atelier qui peut regrouper jusqu’à vingt machines dans un bruit assourdissant ou bien il s’engage comme employé ou surveillant dans les filatures de soie qui se sont développées depuis le milieu du siècle.
Ma famille de Saint Jean du Gard en est l‘exemple type. Sept générations se sont ainsi succédé : quatre faiseurs de bas, un faiseur de bas puis surveillant de filature, un directeur de filature, un acheteur de soie en Chine.
Tailleurs d’habit à Paris du Moyen-Age au XVIIIe siècle
(D’après Les métiers et corporations de la ville de Paris : XIVe-XVIIIe siècles. T3 / par René de Lespinasse,… , Imprimerie nationale (Paris),1886-1897)
Les métiers du vêtement ont formé plusieurs communautés d’ouvriers, établies dès le XIIIe siècle, d’après les spécialités de travail ou les noms des vêtements. Ce sont les conréeurs ou apprêteurs de robes, les tailleurs de robes, couturiers, doubletiers, pourpointiers, juponniers; les chaussiers ou chaussetiers, les braliers de fil, les bonnetiers et autres ouvriers en
tricot; les fripiers ayant le droit de réparer et retoucher les vieux habits; enfin certains armuriers fabricants de cuissards et cottes de mailles, doublés d’étoffes et de molleton à disposer en manière d’habillement. Les conréeurs de robes ont disparu après les règlements donnés par le prévôt Jehan de Marle, en 1392, qui ouvrent notre série; ce texte est resté isolé, comme beaucoup d’autres, sans servir à une association spéciale. Le livre d’Etienne Boileau, la Taille de Paris de 1292 mentionnent accidentellement des conréeurs, en les appliquant à la préparation plutôt des cuirs que des étoffes.
Les couturiers, fréquemment cités dans les règlements et les procès, formaient une partie importante du métier, à titre d’ouvriers couseurs, le travail de la coupe étant fait par le maître tailleur; ils n’ont jamais constitué une communauté séparée, ni laissé aucune trace de règlements. Les doubletiers formaient au même titre une catégorie de valets tailleurs. Les chaussiers qui faisaient les hauts et les bas de chausses ont toujours été en dehors et ont fusionné, au XVIIe siècle, avec les drapiers. Quant aux pourpointiers confectionnant le vêtement court, à la mode au XIVe siècle, ils ont profité de leur spécialité pour s’affranchir des tailleurs dont ils étaient une fraction; mais, en somme, le métier des tailleurs domine toujours et ne perd aucun droit sur tous les genres de confections. Ils ont aussi gardé sous leur dépendance absolue le travail des couturières, comme nos grands couturiers d’aujourd’hui. C’est seulement en 1675, lorsque la mode et la toilette se sont répandues dans les diverses classes de la société, que les maîtresses couturières obtinrent d’être érigées en métier juré.
Au Livre d’Etienne Boileau, les règlements des tailleurs de robes ont dix articles. Les robes étaient alors des costumes pour hommes, variant d’étoffe et d’ornementation selon les individus, mais à peu près de la même forme ample et longue, composée de plusieurs « garnements».
La coupe est réservée aux maîtres tailleurs, la couture est faite par les valets couturiers; le métier important et distingué demande le privilège de l’exemption du guet.
De nouveaux règlements sont rendus peu de temps après Boileau, en 1294. On y trouve les noms des grands tailleurs de l’époque, celui du Roi, de la Reine, de leurs enfants, des princes, de l’évêque de Paris, etc., quatre-vingts maîtres des plus importants de la communauté. Ces articles, » comme ceux d’Etienne Boileau, sont peu étendus. Le prévôt nommera les maîtres; tout le travail se fera en vue dans l’atelier et non dans une chambre dissimulée aux regards du public. Les fripiers se borneront à réparer le vieux, les tailleurs à faire le neuf. Il y aura trois jurés établis dans des quartiers différents. Les statuts de Boileau restaient en vigueur sur les autres points.
En 1358, une réclamation émane des valets couturiers pour obtenir l’autorisation de confectionner des doublets sans avoir à passer par les maîtres tailleurs. Ils déclarent être aussi capables que les doubletiers sur la taille et la couture des doublets. On demande beaucoup, disent-ils, ce genre de vêtement; le peuple sera d’autant mieux servi, qu’il y aura augmentation du nombre d’ouvriers. Les couturiers et doubletiers faisaient encore partie des tailleurs de robes, tandis que les pourpointiers venaient d’être érigés en métier séparé depuis l’année 1323. Cette faveur ne leur fut pas accordée.
Le prévôt Jehan Bernier renouvela les statuts des tailleurs en neuf articles, par lettres du 1er décembre 1366. Il y a quatre jurés. On recherche les moyens d’éviter le tort causé au public par ignorance de coupe, la valeur de l’étoffe étant bien supérieure au prix de la façon. Pour être maître et prendre de l’ouvrage à son compte, il fallait être admis par les jurés, sauf exception pour l’ouvrier occupé dans les maisons des seigneurs et pour la confection des vêtements d’enfants, qui n’étaient pas l’objet d’un privilège de tailleur. Selon l’usage, on livrait son étoffe au tailleur. Quand il manquait le vêtement, les jurés examinaient le défaut, et s’il provenait d’ignorance ou de négligence de sa part, le tailleur devait, en sus de l’amende, une indemnité à la personne.

Pourpointiers
Les doublets pour la vente devaient être garnis d’étoffes neuves en soie ou fil et non de laine ou d’étoupe. Sur commande, le tailleur pouvait les faire au gré de l’acheteur. La confrérie possédait une caisse de secours pour les maîtres pauvres. On accordait des dispenses de chômage pour les vêtements des princes, pour une noce, une assemblée de corps ou toute autre circonstance pressée. Ces statuts ont été confirmés pendant deux siècles avec des modifications portant seulement sur des points de détail. Plus encore que les autres, le métier de tailleur, exigeant de grands soins et des précautions minutieuses, semble préoccupé de la bonne confection et du zèle qu’il faut y apporter. La communauté, pour poursuivre ce but, ne voyait que les amendes. On les augmente sur tous les points en 1402 et en 1467.
De 1506 à 1512, quelques contestations surgissent de la part des couturiers, ouvriers des tailleurs ; puis Henri III, par ses lettres patentes de juin 1583, renouvelle leurs statuts. Le métier y paraît avec tous ses privilèges. Il faut être reçu maître pour avoir le droit de s’occuper des habits et accoutrements d’hommes et de femmes. Si les métiers parisiens accusent tous la préoccupation de protéger leur travail et de l’interdire aux ouvriers indépendants d’une communauté, les tailleurs d’habits semblent être les plus tenaces à défendre leurs privilèges. Les tailleurs des princes attachés à leur maison doivent toujours les suivre et n’avoir ni chambres particulières, ni serviteurs, ni ateliers de maîtrise . Parmi les vêtements, le pourpoint semble avoir remplacé le doublet de 1366; on recommande les saies et casaques des gens d’armes à soigner pour la taille, la couture, l’assemblage en droit fil. L’article 29 expose l’état de la confrérie dans des termes vraiment touchants; fondée et érigée en 1402, elle est entretenue par les dons volontaires des ouvriers; sa caisse fournit d’abord les frais du culte, puis assure de grands secours aux maîtres et compagnons devenus pauvres, infirmes ou aveugles en travaillant au métier. Les autres conditions sont les mêmes qu’auparavant, mais transcrites avec plus de détails, plus de clarté et de précision, permettant d’obtenir une exécution satisfaisante.
Quelques jours après l’enregistrement de ces statuts, les quatre jurés tailleurs obtinrent du Roi, par lettres d’octobre 1583, l’adjonction de huit bacheliers, élus dans les mêmes conditions que les jurés et destinés à les aider dans le travail des visites, très compliqué et très long depuis l’extension du métier dans tous les quartiers de Paris.
Nous avons remarqué une mesure semblable pour tous les corps de métier importants à la fin du XVIe siècle. Les tailleurs réunissaient sous leur administration presque tous les métiers du vêtement, les doubletiers, les pourpointiers et couturiers; ils commandaient sur beaucoup de points les fourreurs, les drapiers chaussetiers, les passementiers, les brodeurs; la plupart des fripiers faisaient fonctions de tailleur pour les étoffes défraîchies. C’était avant tout un travail consistant en façons particulières, variant à l’infini et exigeant des rapports continuels avec des gens de toute classe. Sans être dans les rangs de la hiérarchie ouvrière représentée par les Six Corps, ils devaient prendre une grande place parmi les métiers. Les rivalités, les empiétements, les concurrences ouvertes ou dissimulées étaient fréquentes, les distinctions subtiles. Les vêtements courts n’excédant pas les genoux appartenaient aux pourpointiers, tous les autres plus longs aux tailleurs; les chaussetiers faisaient les vêtements pour les jambes, comme nos culottiers. Avec les différences des modes, on conçoit qu’il était difficile de s’entendre. De plus, il n’y avait pas de métier spécial autorisé pour la toilette des femmes, qui appartenait à la communauté des tailleurs.
La tendance à se grouper entre métiers semblables se montrait alors avec autant d’intérêt qu’on en avait mis, au Moyen âge, à se diviser. Les deux communautés rivales des tailleurs et des pourpointiers tombèrent d’accord et formèrent une liste unique de tous leurs maîtres interdisant, par arrêt du Parlement du 7 septembre 1658, l’entrée dans le métier à tout étranger. L’union fut sanctionnée par un texte de statuts rendu en mai 1660, où le métier élargi et mieux constitué s’établit définitivement. Les tailleurs pourpointiers y affirment pour eux seuls le privilège de faire des habits d’hommes, femmes et enfants, à mesure et sans mesure, avec tous les enjolivements, suivant les termes des statuts de 1583.
Ils font les habits de ballet et de tragédie, les costumes de théâtre et des perfectionnements de toilette, tels que bourrelets, vertugadins, emboutissures. On parle des couturières déjà fort nombreuses dans le métier; il est question de maîtres et maîtresses, ce qui indique l’accession des femmes à la maîtrise. Les ouvriers non reçus dans le métier sont nommés chambrelans.
On employait des toiles cirées et autres étoffes pour doubler et protéger les habits. Mêmes peines pour les vêtements gâchés que pour l’exclusion des tailleurs particuliers des princes. La question de la jurande devient de plus en plus lourde et embrouillée. Un grand garde était élu tous les deux ans pour représenter le métier. Le refus des jurés et maîtres de confrérie les rendait passibles d’une amende de 500 livres. Les quatre jurés sont assistés des anciens ayant passé par les charges et de huit bacheliers; on y ajoute encore les seize nouveaux élus par 120 maîtres pris en nombre égal dans les trois classes des anciens, modernes et jeunes.
Les maîtres s’élevant à 1600, il eût été impossible, vu ce grand nombre, d’aboutir utilement à une élection. La confrérie dédiée à la sainte Trinité s’acquittait des offices et services des défunts, des secours à distribuer aux infirmes; les cotisations étaient de 30 sols pour les maîtres et de 15 pour les compagnons. Les lettres patentes constatent que les deux métiers ont rédigé ces statuts pour se réunir et éviter désormais les frais des contestations fréquentes.

Les offices furent unis à la communauté, les jurés pour 70 000 livres et, en 1745, les inspecteurs des jurés pour 120 000 livres. A la réorganisation de 1776, ils formèrent une communauté avec les fripiers d’habits et de vêtements, la maîtrise commune étant de 400 livres. Des statuts furent passés en 1784.
Les derniers actes sont des contestations sans fin de la part des passementiers à propos des boutons de drap et d’étoffes, à la main ou au métier, qui ont abouti à des désagréments parfois grotesques dont le public faisait les frais. Ils s’arrogeaient le droit de saisir les boutons, même sur les passants. Les bonnetiers, les boursiers de cuir et surtout les fripiers soutinrent aussi de multiples réclamations.
Les statuts des tailleurs d’habits ont été publiés en 1723, 1742 et 1763.
Marchands d’arlequins : revendeurs de restes de repas des tables riches
(D’après « L’Indépendant de Saint-Claude », paru en 1900)
Il existait encore au début du XXe siècle aux Halles de Paris une catégorie d’industriels spéciaux que le langage administratif désignait sous le titre de marchands de viandes cuites ; mais en réalité, ils vendaient toutes sortes de denrées jadis désignées sous le nom de rogatons, collectées sur les tables bourgeoises ou des restaurants, et désignées dans le langage commun par l’argot arlequins.
Leur marchandise était en effet composée de différentes denrées. Ces gens-là recueillaient les « desserts » des tables riches, des ministères, des ambassades, des palais, des restaurants et des hôtels. Chaque matin, eux-mêmes ou leurs agents, traînant une petite voiture fermée et garnie de soupiraux facilitant la circulation de l’air, faisaient faire leur tournée dans les cuisines avec lesquelles ils avaient un contrat. Tous les restes des repas de la veille étaient jetés pêle-mêle dans la voiture et ainsi amenés aux Halles jusque dans la resserre.
Là, chaque marchand faisait le tri de cet amas sans nom, où les hors-d’œuvre étaient mêlés aux rôtis, les légumes aux entremets. Tout ce qui est encore reconnaissable était mis de côté avec soin, nettoyé, paré (c’est le mot) et placé sur une assiette. On se cachait pour accomplir ce travail d’épuration, et le client n’y assistait pas, en vertu de cet axiome, encore plus vrai là qu’ailleurs, qu’il ne faut jamais voir faire la cuisine.

La marchande d’arlequins aux Halles de Paris
Lorsque tout est était terminé, qu’on avait tant bien que mal assimilé les contraires, on faisait l’étalage habilement, mettant les meilleurs morceaux en évidence, tentant la gourmandise des passants par une timbale milanaise à peine éventrée, par une pyramide de brocolis. Tout se vendait, et il n’y eut guère d’exemple qu’un marchand de viandes cuites n’ait fini sa journée vers midi ou une heure. Beaucoup de malheureux, d’ouvriers employés aux halles, préféraient ce singulier genre d’alimentation à la nourriture plus substantielle, mais trop chère, qu’ils trouvaient dans les cabarets et les gargotes. Pour deux ou trois sous ils avaient là de quoi manger.
Chose étrange, les marchands avaient une clientèle attitrée, et ils l’attribuaient uniquement aux cuisines savantes d’où ils tiraient ces débris de nourriture. Des gens riches, mais avares, venaient faire là secrètement leurs provisions : ceux-là, on les reconnaissait promptement à leur mine inquiète et fureteuse ; on s’en moquait, mais, comme ils payaient, on les servait sans leur rire au nez. Tout ce qui pouvait offrir encore une apparence acceptable était donc vendu de cette manière.
Quand un choix indulgent avait été fait, il restait encore bien des détritus qu’il était difficile de classer. Ceci était gardé pour les chiens de luxe. Les bichons chéris, les levrettes favorites, avaient là leurs fournisseurs de prédilection, et, chaque jour, bien des femmes faisaient le voyage des Halles pour procurer aux animaux qu’elles adoraient une pâtée succulente et peu coûteuse. Les os, réservés avec soin, étaient livrés aux confectionneurs de tablettes de bouillon, et, après qu’on en avait extrait la gélatine, revendus aux fabricants de noir animal.
Il n’y a pas de sots métiers, dit-on ; on peut sans peine le croire, si l’on sait que quelques marchands de viandes cuites se retirèrent du commerce après avoir amassé une dizaine de mille livre de rentes en quelques années.
Marchandes de plaisirs rappelant les oublieurs d’antan
(D’après « La Semaine des familles », paru en 1865)
Au XIXe siècle encore, on pouvait entendre crier le soir, dans les rues : Voilà l’plaisir, mesdames, voilà l’plaisir ! Y avait-il alors longtemps que l’on portait ainsi, de maison en maison, cette légère marchandise, si goûtée des enfants et de leurs bonnes ? D’où vient-elle ? De quelle époque date-t-elle ?
C’est que les plaisirs n’avaient pas toujours été ainsi nommés ; on les appelait autrefois dans toute la France, des oublies. Dans notre ancienne société française, les marchands de plaisirs étaient des oublieurs, ils tiraient leur nom des oublies qu’ils vendaient. Oublie, comme le fait remarquer un étymologiste, vient d’oublier, et l’on avait donné ce nom aux gâteaux en question, parce qu’ils sont si légers, qu’un moment après les avoir mangés, on ne s’en souvient plus, on les oublie. Vint un homme d’esprit qui les compara au plaisir, ce fantôme que les fils d’Adam poursuivent, et qui leur échappe au moment où ils l’atteignent. On se souvient souvent, avec un sentiment de jouissance, d’un obstacle surmonté, d’un grand péril auquel on a échappé, et d’une épreuve courageusement subie. De là le vers de Virgile :
Forsan et haec olim meminisse juvabit
on oublie bien vite un amusement, un plaisir. Comme la légère fumée d’une flamme éteinte, ce souvenir fugitif disparaît et s’évanouit.
Il serait difficile d’indiquer la date précise de l’invention des oublies ou des plaisirs. Ce qu’on peut affirmer, c’est qu’on en mangeait déjà au XIVe siècle. Il existe, en effet, un règlement du prévôt de Paris relatif aux oublieurs, mis à la suite de l’ordonnance du 9 septembre 1369. C’était ordinairement dans le carnaval, au cœur de l’hiver, que le commerce des oublies devenait considérable : vers sept heures du soir, quand le couvre-feu avait sonné et que la nuit régnait dans l’ancien Paris couvert de frimas, l’oublieur prenait son coffin rempli d’oublies, qu’il chargeait sur ses épaules et faisait retentir un cri bien connu. Alors les enfants et les servantes se mettaient aux croisées et l’appelaient.
Les oublieurs devaient prendre leurs précautions avant de se rendre à cet appel, car l’ordonnance précitée les condamnait à une amende si, à cette heure tardive, ils entraient chez un juif. D’autres fois, c’étaient de jeunes étudiants de l’Université qui les faisaient monter dans leur logis ; alors cette folle jeunesse leur demandait les dés avec lesquels les oublieurs jouaient leur marchandise contre quelques deniers, et, de gré ou de force, les transformaient en banquiers d’un pharaon où l’on jouait, non plus des oublies, mais de l’argent. C’était encore un cas prévu par les règlements du prévôt de Paris, qui mettaient à l’amende les oublieurs quand ceux-ci, oubliant leurs devoirs, empiétaient sur l’industrie mal famée des brelandiers.
Les oublieurs n’avaient pas le droit de se faire accompagner par un auxiliaire quand ils criaient le soir leur marchandise, cette interdiction le devant sans doute au fait qu’à cette époque la ville n’étant ni éclairée ni sûre : on craignait que, sous prétexte de vendre des oublies, ces marchands ambulants ne pratiquassent une industrie moins innocente et n’assaillissent les passants attardés.

Dessin d’un méreau de la corporation des oublieurs, 1508
Dans cette époque de réglementation, il y avait d’autres ordonnances que les oublieurs devaient observer : il leur était interdit, dans les foires et dans les marchés, d’étaler leurs oublies à une distance moindre de deux toises d’un autre oublieur.
Les oublies se faisaient alors, comme plus tard, dans un moule de fer. Mais il fallait un apprentissage, et il n’était pas donné à tout le monde d’être maître oublieur. Dans cette industrie, comme dans toutes les autres, on était obligé de faire ses preuves. Les oublieurs formaient une corporation qui avait des statuts. Or voici l’article premier de ces statuts : « Que nul ne puisse tenir ouvrouer ni estre ouvrier s’il ne faict en ung jour au moins cinq cents grandes oublies, trois cents de supplication, et deux cents d’estrées. » Cela revenait à plus de mille oublies, et, pour les faire en un jour, même en se levant de bonne heure, il fallait être très exercé, très habile, et avoir la main alerte et prompte.
De ce qui précède il résulte que ce qu’il y a de plus léger au monde, l’oublie ou le plaisir, a vécu plus longtemps que les constitutions qu’on disait immortelles. On avait vu disparaître les dynasties, s’écrouler les monuments les plus solides, tomber les gouvernements, et, après plus de quatre siècles écoulés, on mangeait encore des plaisirs au milieu du XIXe siècle.
C’est toujours pendant la soirée, et surtout pendant les soirées d’hiver, que les marchands et les marchandes de plaisirs parcourent à cette époque les rues de Paris, en criant leur marchandise. Seulement, l’ancien coffin des oublieurs du Moyen Age est remplacé par une espèce de petit tonneau à la forme allongée, et le tourniquet, avec son aiguille, qui marque sur un cadran le nombre des plaisirs ou des macarons gagnés, est venu se substituer aux dés de l’oublieur. L’ancienne crécelle est restée, et son cri aigu se marie avec les sifflements de la bise hivernale.
L’intonation du marchand n’avait pas beaucoup changé : Voilà l’plaisir, mesdames, voilà l’plaisir ! Si l’on se trouve au chevet d’un cher malade qui sommeille, combien on appréhende le passage de la marchande de plaisirs avec sa voix aiguë comme un clairon et nasillarde comme la clarinette d’un aveugle enrhumée par le brouillard ! On guette longtemps à l’avance le bruit grinçant de sa crécelle et la cantilène accoutumée, dont il est accompagné, et quand la rafale vous apporte les sons de cette fanfare, affaiblie par l’éloignement, on descend quatre à quatre l’escalier pour aller acheter à la terrible marchande une partie de ses plaisirs, à la condition expresse qu’elle ne fera pas retentir sa bruyante interpellation devant la maison. Elle cède, parce qu’elle est marchande et que, comme elle le dit, « il faut, avant tout, gagner sa pauvre vie », mais, elle cède à regret, parce qu’elle est aussi artiste. Elle tient presque autant à son appel : Voilà l’plaisir, mesdames, voilà l’plaisir ! que Dupré tenait à son ut de poitrine, et Mario à son ariette farorite, et elle fait un véritable sacrifice en acceptant votre argent.
Comme l’industrie a fait au XIXe de grands progrès, la marchande de plaisirs a étendu la sienne. Elle a joint en effet alors aux oublies de nos pères, qui sont toujours l’objet principal de son commerce, les macarons, les sucres d’orge, les gaufres et les croquets. La grande manufacture des plaisirs et des gaufres, à Paris, le quartier général des marchands et des marchandes de plaisirs, est dans ce temps-là situé aux Champs-Élysées, dans l’avenue Matignon, au coin de la rue de Ponthieu. C’est là qu’ils viennent s’approvisionner. C’est là aussi que s’arrêtent bien souvent les promeneurs en équipages et les piétons : L’enfant en montrera le chemin à sa mère.
Aux heures où les promenades publiques, les Champs-Élysées, les Tuileries, le Luxembourg, sont fréquentées par les enfants, les marchandes de plaisirs circulent dans les allées et vont offrir leur légère marchandise aux groupes dispersés sous les grands arbres. « Voilà la marchande de plaisir ! » s’écrient Armand, Berthe, Gaston et tous les bébés en chœur. Les mamans et les bonnes tirent leur bourse. Un plaisir n’a jamais troublé ou arrêté une digestion. Et puis, cette pâte légère est si cassante et si friable, que les petits oiseaux déjeunent toujours de la desserte des petits enfants. Qu’un coup de vent s’élève, voilà la moitié du plaisir qui s’envole et s’émiette sur le sable : c’est chère lie pour les moineaux francs.
A l’époque où le jardin des Tuileries était un jardin aristocratique, c’est-à-dire à l’époque où l’on n’y fumait pas et où Guignol n’y exhibait pas ses triviales marionnettes, les plaisirs n’entraient que par contrebande dans le jardin. On voyait une nourrice tenant sous des flots de mousseline un poupon qui ne criait jamais et semblait dormir toujours : c’était la contrebande des plaisirs qui pénétrait dans le jardin sous la forme d’un nourrisson. Quand la fausse nourrice voyait que les inspecteurs avaient le dos tourné, elle s’approchait des chaises où les mamans et les bonnes étaient assises, et, découvrant sa marchandise dorée, elle leur faisait ses offres de service. Cela paraissait bien bon aux bébés d’attraper les inspecteurs, qui tournaient systématiquement le dos à cet innocent manège ! S’il n’y a pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre, il n’y a pas de meilleurs aveugles que ceux qui sont décidés à ne pas voir.
Cette stratégie devint par la suite inutile ; le laisser faire et le laisser passer régnèrent aux portes des Tuileries comme ailleurs, et l’époque où tout le monde mangeait des plaisirs dans ce beau jardin, quoique personne ne fût censé en vendre, ne fut plus qu’un souvenir.
Le XIXe siècle marqua le déclin de la profession : les palais, devenus plus délicats et plus exigeants, réclamaient des pâtisseries moins rudimentaires et moins primitives ; de même que les marchands de coco, ces Ganymèdes en plein vent qui versaient leur nectar à deux liards la timbale, n’existaient à la fin de ce siècle qu’à l’état d’échantillons et de memento du passé, depuis que la choppe de bière, le verre de punch, le mazagran et le verre d’absinthe avaient étendu leur empire sur les consommateurs populaires, la marchande de plaisirs s’en allait.

Marchande de plaisirs
Merciers
(D’après un texte paru en 1908)
On disait au Moyen Age : « Merciers, marchands de tout, faiseurs de rien ». C’était l’exacte définition de ce métier. Chaque artisan à l’origine vendait seulement ses produits : mais tous les métiers n’existaient pas en si grand nombre et avec la même importance dans chaque ville. Il était donc indispensable qu’il y eût des gens pour se charger de rassembler les marchandises les plus diverses et les mettre à la disposition des acheteurs. Mais les différents industriels veillaient jalousement à leurs privilèges, et de tout temps ils surveillèrent attentivement les marchands pour les empêcher de rien fabriquer.

Un mercier ambulant vers 1680
Ces marchands, qui servirent ainsi au Moyen Age d’intermédiaires entre le public et les fabricants, on les appela merciers. Ce mot, qui n’éveille pour nous que l’idée d’un petit commerce borné à quelques articles de lingerie, à quelques accessoires de toilette, et à quelques-uns des instruments nécessaires à la couture. Toutefois, le mot mercerie avait bien plus d’étendue ; il vient du mot latin merx, qui signifie tout ce qui se vend. Un mercier, c’était à l’origine un négociant en gros.
On distinguait deux sortes de merciers. D’abord ceux qui allaient au loin chercher les marchandises précieuses : ils se rendaient dans ces curieuses foires, où les marchands de tous pays se retrouvaient pendant quelques semaines et d’où ils revenaient dans leur patrie avec des mulets chargés de ballots. Puis il y avait les merciers sédentaires, qui recevaient des premiers les marchandises coûteuses ou qui commandaient aux fabricants de la ville où ils se trouvaient les objets dont ils avaient besoin. La corporation des merciers est l’une des plus anciennes ; au XIIe siècle, en 1137, nous les rencontrons dans un acte où on leur concède un droit de place dans les halles de Champeaux. Comme tous les métiers tenant de près ou de loin à la mode, aux habits ou aux armures, les merciers eurent dès cette époque une importance exceptionnelle : les chapeliers de plumes de paon, si considérables et si en faveur, ne comptaient guère au prix d’eux ; cette prépondérance venait sans doute du fait que les merciers employaient un peu de toutes les matières précieuses, l’or, l’argent dans les orfrois et les bordures, les perles et les joyaux dans les broderies.
Les merciers parisiens étaient groupés sur la rive droite au Moyen Age ; les plus estimés se trouvaient, au XIIe siècle, rue Quincampoix, puis ils se rapprochèrent des Halles où, d’ailleurs, depuis le règne de Louis VII, ils possédaient une place fixe. Plus tard, quelques-uns passèrent l’eau ; de bonne heure, beaucoup d’entre eux s’installèrent au Palais de justice, dans la galerie qui faisait face à la cour d’entrée.
Au treizième siècle, ils vendent et fabriquent eux-mêmes, et comme les femmes peuvent travailler du métier, il y a des maîtres et des maîtresses, des apprentis et des apprenties. La fabrication porte sur les orfrois, merveilleuses applications de broderies sur soie, sur les bordures plus simples, les bourses, les bas, les menus objets de toilette brodés et ornés. Cette fabrication est très surveillée. Les merciers ne peuvent broder sur parchemin ou toile ; la soie seule est autorisée.
Les produits d’Orient, en général, étaient peu estimés ; on prohibait l’or de Lucques et de Chypre qui était un composé de soie et d’or ; on empêchait le mélange du vieux et du neuf, celui du fer avec l’or, et les quatre prud’hommes du métier avaient ordre de dépecer sans pitié tout ouvrage fabriqué contrairement à ces prescriptions. Une des préoccupations de ces gardes était d’empêcher l’emploi des perles fausses, vendues à profusion malgré les défenses, et dont l’application sur une broderie exposait à la destruction complète de l’ouvrage.
Le Dit du mercier, petit poème composé spécialement sur ce métier, énumère longuement les objets mis en vente par les maîtres, et qui tous étaient des merveilles de richesse et de splendeur. Certaines statues de nos cathédrales attestent la réalité de ces descriptions ; celles du portail occidental de Chartres, par exemple, donnent une idée de la perfection des travaux de mercerie. Tantôt ces orfrois étaient quadrillés, diaprés, échiquetés comme un damier, tantôt ils étaient semés de cabochons, de perles, de saphirs fixés au galon.
A dire le vrai, c’étaient les gens d’église et non les laïques qui employaient le plus ces riches ornements. Les séculiers ne les cousaient guère qu’à l’encolure des bliauts ou des robes, car ils étaient lourds et se pliaient mal aux caprices des étoffes légères ; mais il n’en reste pas moins acquis que la consommation énorme de ces objets avait donné aux merciers une situation particulière parmi les corps de métiers.
Les statuts des merciers furent confirmés à diverses reprises. Ils avaient ce qu’on appelait le roi des merciers pour chef de la corporation, et ce chef accordait le brevet de maître. Après une assez longue durée, la charge de roi des merciers, ayant été supprimée provisoirement par le roi François Ier, fut rétablie par Henri III. En 1597, elle fut définitivement mise de côté par ordre de Henri IV. Quant aux statuts, d’abord énumérés dans Etienne Boileau, ils furent rappelés en 1407 et 1418, et imprimés au milieu du XVIIIe siècle.

Marchand de rubans en 1774
Les maîtres vendaient alors un peu de tout, des dentelles, des galons, des étoffes, des broches d’or et d’argent, des toiles et des soies, même des lainages. Ils payaient leur maîtrise mille livres, et la corporation portait d’argent à trois vaisseaux dorés d’un soleil levant, ce qui était une ancienne flatterie au roi Louis XIV, de même d’ailleurs que la devise : « Nous te suivrons partout. »
Au XVIIe siècle, quand les communications devinrent plus faciles, et que des produits plus nombreux purent s’entasser dans la boutique des merciers, la mercerie se partagea en une vingtaine de spécialités, et on eut ainsi des marchands joailliers, des marchands quincailliers, des marchands papetiers, des marchands bimbelotiers, qui vendaient des jouets d’enfants. Mais tous ces négociants avaient besoin de faire précéder le nom du métier dont ils vendaient les produits du mot marchand pour rappeler qu’ils ne fabriquaient rien eux-mêmes, et se mettre ainsi à l’abri des procès que les industriels n’auraient pas manqué de leur intenter.
Au XVIIIe siècle, le plus célèbre des magasins de mercerie à Paris était le Petit Dunkerque, qui se trouvait au bord de l’eau, à l’angle du quai Conti et de la rue Dauphine.
Au XIXe siècle, l’équivalent des merceries d’autrefois furent les grands magasins de nouveautés. Mais, tandis que les merceries avant 1789 n’étaient le plus souvent que des boutiques sombres, les magasins de nouveautés étaient de vrais palais.
Au temps de Louis-Philippe, ils étaient encore petits et mesquins ; mais avec la fin du Second Empire, ils s’agrandirent ; des maisons comme le Louvre ou le Bon Marché, célèbres dans le monde entier, sont devenues, par suite du renouvellement constant de leurs marchandises et de leurs applications à suivre les mille changements de la mode, de véritables expositions permanentes.
Stationnaire : métier lié au livre avant l’avènement de l’imprimerie
(D’après « La Science française », paru en 1891)
Malgré le zèle de nos savants et de nos paléographes, il existe encore des coins inexplorés de nos vieilles coutumes. Ainsi d’un métier lié au monde du livre entre le XIIIe et le XVe siècle, et dont on trouve trace dans le cartulaire de l’Université de Paris : stationnaire, à ne point confondre avec libraire.
D’après les statuts de l’Université de Paris, ceux qui faisaient, du XIIIe au XVe siècle, le commerce des manuscrits, se divisaient en deux classes : les libraires et les stationnaires. Un seul et même titulaire pouvait exercer les deux emplois ; il existait toutefois une distinction entre l’un et l’autre ; elle est prouvée non seulement par l’usage de deux noms différents, qui n’étaient point absolument synonymes, mais aussi par certaines prescriptions qui ne s’adressaient qu’à l’un d’eux.
Auteur d’une Histoire de l’Université de Paris (1761) en sept volumes in-12, le littérateur et historien Jean-Baptiste Crevier (1693-1765) attribue l’origine de l’expression stationnaire à l’une des significations du mot latin statio, qui désignait un entrepôt, et il fait remarquer, avec raison, que le commerçant en livres n’était, à vrai dire, à cette époque, que l’entrepositaire de ceux qui désiraient vendre quelque manuscrit, et l’intermédiaire qui se chargeait de le faire passer aux acheteurs. Sans doute, au Moyen Age, la librairie consistait surtout à s’occuper de l’échange ou de la location des manuscrits existants, de la recherche, moyennant un très faible salaire, d’un acquéreur pour le manuscrit à vendre et de l’exécution du mandat que donnait le propriétaire vendeur du manuscrit de lui en trouver un prix juste et raisonnable.
Le libraire proprement dit se contentait du commerce des manuscrits existants, recevait en dépôt les exemplaires à vendre, leur cherchait acquéreur, se créait dans les écoles ou parmi les magistrats et les fonctionnaires royaux, une clientèle qui avait recours à son intermédiaire pour des opérations d’échange, d’achat ou de vente. Il avait un domicile certain et pouvait tenir boutique. Si ses ressources lui permettaient de devenir propriétaire de quelques manuscrits, il ne cherchait pas toujours à les vendre ; il les mettait plutôt en location, car le prêt des manuscrits donnait surtout lieu à de nombreuses transactions. Il avait le droit d’exiger un gage de l’emprunteur.

Scriptorium (atelier de copistes) du monastère de l’Escurial au XIIIe siècle
Le stationnaire, vulgairement appelé aussi libraire parce qu’il s’occupait également de l’échange ou de la location, de la vente ou de l’achat des manuscrits existants, joignait à ce commerce une industrie fort importante : il faisait faire sous sa direction, par des clercs ou copistes à son service, de nouvelles copies de manuscrits anciens ou des copies d’une œuvre nouvelle due à l’un des maîtres de l’Université. Il devenait, par ce fait, l’éditeur de l’époque. Aussi avait-il non seulement une boutique, mais un bureau de copistes, véritable atelier où l’enlumineur achevait pour les exemplaires de luxe l’œuvre de l’écrivain.
Suppôts et officiers de l’Université, les libraires et les stationnaires de Paris, qui n’étaient point confondus parmi les autres métiers ni considérés comme artisans, étaient admis à jouir de trois privilèges principaux : 1° privilège de juridiction ; 2° privilège d’exemption des tailles ; 3° privilège de la dépense du guet et de la garde des portes. Les libraires et stationnaires sur lesquels l’enquête universitaire avait été favorable, qui avaient fourni bonne et valable caution, qui s’étaient soumis aux serments prescrits et auxquels le recteur avait délivré des lettres de congé et des licences munies du sceau de l’Université, étaient placés, en qualité de libraires et de stationnaires jurés, sous la protection de l’Université.
Un document du 4 décembre 1316 ne signale à cette époque que treize noms de libraires jurés. Il est vrai que c’était une époque tourmentée, car le 11 juin précédent, l’Université avait publié une liste de vingt-deux anciens libraires qui s’étaient refusés à prêter serment. Un document de septembre 1323 énumère vingt-huit libraires. En 1368, les lettres patentes de Charles V, accordées pour la dispense du guet, mentionnent vingt-cinq libraires ou écrivains jurés. Au XVe siècle, le nombre paraît définitivement ramené à vingt-quatre.
La majorité des libraires jurés était de nationalité française ; mais les étrangers pouvaient être également admis à remplir cet office. Si l’Université était jalouse de ses droits et de son autorité, elle se montrait également soucieuse des intérêts de ses suppôts et officiers. Afin de mieux obtenir les services qu’elle en attendait, elle cherchait à se les attacher par les avantages que leur offrait l’exercice de leur emploi garanti par un véritable monopole.
Cette autorité est restée à l’Université encore pendant quelque temps après l’invention de l’imprimerie ; elle continua à contrôler la valeur morale et orthodoxe des œuvres et à couvrir les libraires de sa protection. Son influence commença à être menacée dès 1618 par le désir d’indépendance des libraires, qui obtinrent, à cette époque, un syndic et des adjoints au détriment des quatre grands libraires de l’Université ; elle fut vivement attaquée au milieu et à la fin du XVIIe siècle, pour s’effacer pendant le XVIIIe siècle et disparaître définitivement en 1789 lors de la Révolution.
Enseignes à travers les âges : fruits d’une inspiration goguenarde
égayant maisons et rues
(D’après « Le Petit Journal. Supplément du dimanche », paru en 1914)
De pittoresques enseignes décoraient jadis les boutiques parisiennes et donnaient aux rues de la ville la physionomie la plus originale. Quel spectacle amusant ce devait être que celui de ces rues étroites et tortueuses d’autrefois, avec toutes ces grandes enseignes qui se balançaient au bout de longues tringles de fer. Et si une ordonnance de 1766 exige qu’elles ne prennent plus la forme, dangereuse pour les passants, d’une potence, elles n’en connaissent pas moins un fabuleux essor, devenant même le support de messages politiques facétieux au XIXe siècle.
Le Moyen Age fut, dans nos vieilles villes, l’époque où les enseignes se multiplièrent. En ce temps-là, les rues ne portaient pas de nom, les maisons n’avaient pas de numéros. C’est par quelque enseigne connue qu’on désignait les unes et les autres. La place Saint-Michel dut son nom à une maison qui portait pour enseigne la figure de l’archange terrassant le démon ; de même la rue de l’Homme Armé, qui ne disparut qu’au XIXe siècle ; et aussi la rue de l’Arbre-Sec et celle du Chat-qui-pêche, qui existent encore aujourd’hui.
A Paris alors, les marchands des divers métiers avaient la coutume de mettre, à leurs fenêtres et sur leurs portes des bannières en forme d’enseignes, où se trouvaient figurés le nom et le portrait du saint ou de la sainte qu’ils avaient choisi pour patron ; cependant, on rencontrait aussi, parfois, au lieu d’une figure de moine ou de vierge martyre, divers emblèmes ou rébus qui exerçaient l’esprit sagace des curieux, dont le plaisir était grand de chercher le sens caché de l’enseigne.

Il existait autrefois à Paris, une rue qui portait le nom de rue du Bout-du-Monde, parce qu’il y avait, dans cette rue, une enseigne sur laquelle on avait représenté un bouc, un duc (oiseau) et un monde. Autres exemples : A l’Assurance (Un A sur une anse) ; Au puissant vin (Au puits sans vin) ; A la vieille science (Une vieille femme qui sciait une anse). Ces compositions naïves suffisaient à amuser nos aïeux. Le goût s’en perpétua presque jusqu’à nos jours. Vers le milieu du XIXe siècle, on voyait encore sur le boulevard du Temple, près du cirque Olympique, un limonadier dont l’enseigne représentait un paysan qui coupait un épi, avec, au-dessous, cette légende : A l’Epi scié.
Les plus savants personnages ne dédaignaient pas d’user de ces jeux de mots dans leurs enseignes. C’est ainsi que le médecin Coitier, qui soigna Louis XI, et que le roi voulut faire pendre en un jour de mauvaise humeur, s’était fait bâtir une maison, sur laquelle il avait mis cet à peu près : A l’Abri-Coitier.
Mais nos aïeux ne se contentaient pas toujours de l’enseigne représentée par un bas-relief sculpté dans la muraille ou par un tableau se balançant au-dessus de l’entrée de la boutique. Ils employaient aussi l’enseigne vivante. Ainsi, la Truie qui file, le Coq-Héron, le Singe-Vert, étaient des animaux en cage dont l’adresse émerveillait les passants, et dont l’éducation prouvait la patience de l’industriel du XVe ou du XVle siècle.
A cette époque, l’enseigne était obligatoire. Une ordonnance de 1567 prescrit à ceux qui veulent obtenir la permission de tenir auberge, de faire connaître au greffe de la justice « leurs noms, prénoms, demeurances affectes et enseignes ». Un édit de Henri III de mars 1577 ordonne aux aubergistes de placer une enseigne à l’endroit le plus apparent de leurs maisons « à cette fin que personne n’en prétende cause d’ignorance même les illettrés ». Mais sous Louis XIV l’enseigne n’est plus que facultative. La pratique n’en diminue pas pour cela. Il n’est point à Paris, une boutique sans enseigne.
Même, la fureur des grandes enseignes parlantes prend à cette époque un développement considérable. Chacun veut avoir une enseigne plus volumineuse que celle de son voisin. Et tous ces attributs gigantesques qui se balancent en avant des maisons, au bout de longues potences, ne vont pas sans quelques inconvénients. Si bien qu’au XVIIIe siècle, le lieutenant de police Antoine de Sartine (1759-1774) se résolut à mettre ordre à cet abus. Par ordonnance de 1766, il prescrivit la suppression de ces potences menaçantes et ordonna que les enseignes seraient dorénavant appliquées en tableaux sur les murs, scellées de plâtre et cramponnées en haut et en bas. Le pittoresque y perdit, mais la sécurité des passants y gagna.
Mercier, dans son Tableau de Paris, a applaudi à cette réforme. « Les enseignes, écrit-il, sont maintenant (1780) appliquées contre le mur des maisons et des boutiques ; au lieu qu’autrefois elles pendaient à de longues potences de fer ; de sorte que l’enseigne et la potence, par les grands vents, menaçaient d’écraser les passants dans les rues. Quand le vent soufflait, toutes ces enseignes, devenues gémissantes, se heurtaient et se choquaient entre elles ; ce qui composait un carillon plaintif et discordant… De plus, elles jetaient, la nuit, des ombres larges qui rendaient nulle la faible lueur des lanternes.
« Ces enseignes avaient pour la plupart un volume colossal, et en relief. Elles donnaient l’image d’un peuple gigantesque, aux yeux du peuple le plus rabougri de l’Europe. On voyait une garde d’épée de six pieds de haut, une botte grosse comme un muid, un éperon large comme une roue de carrosse, un gant qui aurait logé un enfant de trois ans dans chaque doigt, des têtes monstrueuses, des bras armés de fleurets qui occupaient toute la largeur de la rue. La ville, qui n’est plus hérissée de ces appendices grossiers, offre pour ainsi dire, un visage poli, net et rasé ».
Et Mercier termine son article par un brillant éloge d’Antoine de Sartine, qui supprima impitoyablement le pittoresque des enseignes à potence. D’ailleurs, dès cette époque, les rues portaient des noms inscrits sur des plaques de tôle à toutes les encoignures ; de ce fait, les enseignes étaient moins indispensables qu’auparavant. Mais les maisons n’étaient pas encore numérotées. Une ordonnance de 1768 avait bien prescrit ce numérotage, mais les habitants n’en avaient guère tenu compte ; et ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que, dans les voies les plus importantes de la capitale, les maisons portèrent régulièrement des numéros.
Les meilleurs artistes du temps passé n’ont pas dédaigné de peindre ou de sculpter des enseignes. Dans la plupart de nos vieilles villes, à Rouen, à Reims, à Amiens, à Beauvais, on en trouve qui sont, à coup sûr, l’œuvre de « tailleurs d’images », d’un indiscutable talent. On note également nombre d’enseignes peintes par les artistes les plus célèbres du XVIIIe et même du XIXe siècle. Tout le monde connaît, au moins par la gravure, la fameuse enseigne que Watteau peignit pour son ami Gersaint, le marchand de tableaux du pont Notre-Dame.
Chardin, le peintre exquis des intérieurs bourgeois, peignit dans sa jeunesse une enseigne pour un chirurgien parisien. Le panneau, qui n’avait pas moins de neuf à dix pieds de long, représentait un homme blessé d’un coup d’épée, qu’on apportait dans l’officine du chirurgien. Le commissaire, le guet, des femmes et toutes sortes de curieux remplissaient la scène et, détail intéressant, Chardin avait pris pour modèles des personnages de son tableau, les principaux membres de sa famille. La boutique pour laquelle l’enseigne fut faite était située en bas du pont Saint-Michel.
Le peintre Pierre Prudon (1758-1823) dit Prud’hon fit une enseigne pour un chapelier. Elle représentait deux ouvriers travaillant le feutre au milieu d’un amoncellement de chapeaux. En 1833, le peintre et dessinateur Auguste Raffet (1804-1860), en pleine célébrité, peignait une enseigne pour un fabricant de papier qui faisait l’angle de la rue Saint-Marc et de la place des Italiens, aujourd’hui place Boieldieu. Ce tableau représentait une accorte cantinière portant, au lieu du traditionnel tonnelet, une boîte à papier. François Boucher (1703-1770) fit une enseigne pour une sage-femme ; Philibert-Louis Debucourt (1755-1832) en peignit plusieurs : une pour un négociant de la place des Trois-Mariées, aujourd’hui place de l’École, à côté de la mère Moreaux ; et une autre pour Corcelet, le marchand de primeurs à l’enseigne du Gourmand. Le peintre Narcisse Diaz (1807-1876) décora de superbes panneaux une boutique de fruitier du marché Saint-Honoré.
Jean-François Millet (1814-1875), qui réalisa le célèbre Angélus (1859), dut peindre des enseignes pour vivre. Au coin de la rue Notre-Dame-de-Lorette et de la rue Saint-Lazare, il composa pour un magasin une enseigne représentant Notre-Dame-de-Lorette écrasant le serpent. Vers 1862, il exécuta peur un marchand de vins deux stores allégoriques : la Vendange et la Moisson. A Cherbourg, il travailla pour un laitier et pour une sage-femme. Il fit même, pour la façade d’une baraque foraine, un tableau représentant le Maréchal Bugeaud à la bataille d’Isly ; et plus tard, le pauvre artiste disait mélancoliquement que c’était là, peut-être, une de ses meilleures toiles.
Sait-on qu’une enseigne, un jour, alarma le pouvoir ? Un restaurant de Paris fondé en 1792 — fermé en 1936 —, Le Bœuf à la mode, portait au début du XIXe siècle sur son enseigne un bœuf orné d’un châle, d’un chapeau à brides, en un mot habillé à la mode du Directoire (1795-1799), celle qui avait vu éclore les Incroyables et les Merveilleuses. C’est cette enseigne qui eut l’étonnante fortune d’inquiéter le gouvernement de Louis XVIII. L’Intermédiaire des chercheurs et curieux retrouva aux Archives un rapport de police ainsi conçu :
« Paris, 13 juin 1816.
« Un restaurateur nouvellement établi rue du Lycée, n°8, en face le corps de garde attenant au Palais-Royal, vient de faire apposer une enseigne au-dessus de son local qui a pour titre : Le Bœuf à la mode. Cet animal, symbole de la force, fait déjà parler beaucoup par la nature de son harnachement et de sa coiffure, qui se compose d’un cachemire rouge, d’un chapeau de paille surmonté de plumes blanches et orné d’un ruban bleu ; un autre ruban de même couleur est autour de son col et portant une espèce de toison d’or, comme la portent les souverains. Le chapeau qui représente la couronne est rejeté en arrière et prêt à tomber »,
« Cette raison, et particulièrement la réunion des trois couleurs réprouvées, ne paraissent être placées qu’avec une mauvaise intention, enfin il n’y a pas jusqu’à la classe vulgaire qui ne voie dans cette allégorie, une caricature des plus sales contre Sa Majesté.
« Signé : LE FURET ».

Enseigne du restaurant » Le Bœuf à la mode » en 1816
Ces indications du Furet émurent suffisamment le comte Élie Decazes, préfet de police de Paris depuis le 7 juillet 1815, pour qu’il prescrivît un supplément d’enquête, d’autant qu’un autre rapport affirmait que les garçons du restaurant tenaient de mauvais propos :
« Je vous invite, écrivait Decazes, à faire vérifier sur le champ, ce qu’il pourrait y avoir de fondé dans ces remarques et à vous assurer des opinions politiques des propriétaires de l’établissement. Je n’ai pas besoin de vous engager à faire mettre dans cette espèce d’enquête, beaucoup de discrétion, et s’il paraissait convenable de faire disparaître cette enseigne, d’avoir soin que l’opération ait lieu sans éclat ».
Il faut croire que l’enquête définitive ne fut pas trop défavorable ou que l’esprit politique l’emporta sur un zèle maladroit ; l’enseigne resta et Louis XVIII n’en fut pas renversé.
Au surplus, il arriva parfois à l’enseigne de faire de la politique. Vers 1830, il y avait à Paris un pâtissier nommé Leroy qui avait écrit sur sa boutique : Leroy fait des brioches. La police s’émut de cette inscription qui semblait censurer irrespectueusement les actes de Louis-Philippe. Le commissaire appela le pâtissier et lui ordonna de changer son enseigne. Ce que fit le facétieux commerçant en remplaçant l’inscription par celle-ci : Leroy continue à faire des brioches. Il est à ce sujet assez amusant de noter qu’à Reims, déjà 40 ans auparavant selon Prosper Tarbé (Reims. Essais historiques sur ses rues et ses monuments, paru en 1844), « en 1790 demeurait sous les Loges un estimable pâtissier nommé Leroy. Déjà dans ce temps on avait trouvé le secret des réclames, et la science des enseignes était en progrès. Notre pâtissier donc écrivit au-dessus de sa porte : Leroy fait ses brioches. La monarchie était alors sur son déclin et l’on aimait à rire à ses dépens. »
C’est dans les mêmes années 1830 qu’un fruitier de la rue Saint-Denis fit peindre sur sa boutique le portrait de Louis-Philippe, avec cette inscription : « Spécialité de poires » — on sait que le célèbre Daumier fit paraître en 1831 dans le journal qu’il dirigeait, un portrait caricatural de Louis-Philippe intitulé La Métamorphose du roi Louis-Philippe en poire.
La République de 1848 ne fut pas mieux traitée par l’enseigne. Sur sa devanture, un marchand de tabacs avait fait peindre trois blagues au-dessous de la devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Et comme enseigne, il avait écrit : « Aux trois blagues ». Un numéro du Phare de la Loire de 1930, donc un siècle plus tard, nous apprend qu’il existe alors un bureau de tabac d’une bourgade située non loin de Périgueux, arborant cette même enseigne.
Que de choses il y aurait à dire sur l’humour de l’enseigne. L’esprit goguenard de nos pères se donna là libre carrière. Il y avait jadis, à Troyes, une enseigne avec ce titre : Au trio de malice. Elle représentait un singe, un chat et une femme. Et quelle variété de fantaisie dans les enseignes poétiques. On mentionnera le fameux quatrain inscrit sur la boutique d’un coiffeur de la rue Basse-Porte-Saint-Denis :
Passants, contemplez la douleur
D’Absalon pendu par la nuque.
Il eut évité ce malheur
S’il eût porté perruque.
Les coiffeurs se sont d’ailleurs signalés de tout temps par l’originalité poétique de leurs enseignes. On signalait, au début du XXe siècle, l’enseigne d’un perruquier de Brie-Comte-Robert, M. Toulemonde :
Sans parcourir le monde entier,
Sans voyager sur l’onde
Entrez chez ce perruquier
Vous verrez tout le monde.
Car l’esprit que prodiguaient nos pères dans leurs enseignes n’a pas complètement disparu. Mais ce sont les enseignes elles-mêmes qui n’existent plus guère. Dans son Voyage aux bords du Rhin, Victor Hugo disait : « Où il n’y a pas d’églises, je regarde les enseignes ; pour qui sait visiter une ville les enseignes ont un grand sens ». Hélas ! l’illustre poète n’aurait plus grand chose à regarder aujourd’hui.
Des anciennes boutiques aux grands magasins : naissance d’un commerce nouveau
(D’après « Paris ou le Livre des Cent et un » (tome 15), paru en 1834)
Quelques années après l’apparition du Petit Saint-Thomas en 1830, premier grand magasin parisien, et cependant que ce type de commerces commence de prendre l’avantage sur les anciennes boutiques, Auguste Luchet, romancier et auteur dramatique, nous entretient de l’origine de ce qui constitue alors une profonde mutation non seulement sémantique mais encore des moeurs de notre société. L’essor de ces magasins d’un nouveau genre le devrait à l’ingéniosité d’un marchand de nouveautés prenant le parti de tourner le dos au marchand en gros et de se lancer dans une réclame et un démarchage du client très offensifs…
C’est dans un article paru en 1834 au sein du quinzième et dernier tome de Paris ou le Livre des Cent et un, qu’Auguste Luchet brosse un portrait détaillé des techniques employées par les nouveaux magasins pour détrôner sans faille les boutiques de nos aïeux.
Un observateur très profond et très spirituel terminait dernièrement par ces mots la physiologie du Boutiquier, écrit Luchet : « Le boutiquier ne dit plus : Ma boutique ; il dit : Mon magasin. Il ne parle plus de ses pratiques, mais bien de sa clientèle. Il n’a plus de garçons pour servir, ce sont des commis. Il ne vend pas de telle ou telle marchandise, il tient tels et tels articles. Il ne s’intitule plus marchand mercier, c’est aujourd’hui un commerçant en merceries ; épicier, il se dit négociant. Autrefois il comptait sa recette, maintenant il fait sa caisse. Ce n’est plus un mémoire qu’il donne à ses pratiques, c’est une facture. Il disait au temps passé : J’écris ma vente du jour ; il dit aujourd’hui : Je tiens mes écritures. Encore quelques jours, le premier garçon s’appellera sous-chef, et le comptoir bureau. »
On croirait pouvoir conclure de tout ceci qu’il n’y a plus de boutiquiers, poursuit le romancier ; car boutiquier vient évidemment de boutique : le Dictionnaire de l’Académie, comme le remarque lui-même l’auteur de la physiologie du boutiquier, le Dictionnaire de l’Académie définit le boutiquier homme tenant boutique, comme l’épicier homme qui vend des épices. Les choses étant ainsi, je trouve logique, si nous supprimons la boutique, que nous supprimions le boutiquier. Le dérivé tient essentiellement à la racine ; et si la boutique une fois destituée, nous la remplaçons par le magasin, il faut que le boutiquier devienne pour nous un être de raison, dont l’appellation gothique ira grossir le nombre des synonymes injurieux ; il faut consentir à dire boutiquier de la même manière que nous disons épicier. Or, chacun sait aujourd’hui que le mot épicier ne signifie plus tout bonnement homme qui vend des épices.
Si nous devons en croire des renseignements respectables, nous explique Auguste Luchet, ce fut un marchand de nouveautés qui osa le premier appliquer le mot magasin à la chose boutique. Magasin, mot arabe (maghazin) qui signifie trésor, s’entendait jadis d’un vaste local où les marchandises étaient déposées en attendant la vente. Cette expression, usée aujourd’hui, avait alors quelque chose de sonore et de grandiose qui flattait l’amour-propre et excitait l’envie. Avoir un magasin, exploiter des magasins, c’était faire le grand commerce. La possession du magasin élevait le simple marchand au rang de négociant. Le marchand de nouveautés, homme de luxe, homme fashionable, ayant étudié au collège, journellement entouré de riches étoffes qu’il vendait à de belles dames, se trouva bientôt gêné de n’être que l’égal d’un mercier, d’un bonnetier, et d’avoir pour supérieur l’épicier en demi-gros son voisin.
Jusqu’alors, fidèle à ce vieux principe du boutiquier, qu’il ne faut jamais faire de provisions, et que la spéculation ne peut pas être le fait d’un débitant, le marchand de nouveautés s’était modestement résigné à considérer le marchand en gros du quartier des Bourdonnais ou de la place des Victoires comme la source la plus directe qui pût alimenter ses rayons, ou ses placets, pour me servir d’une expression plus anciennement consacrée. Cette manière d’opérer était fort sage : le marchand de nouveautés finit par la trouver ignoble. Il achetait au jour le jour, il n’acheta plus qu’une fois par semaine. Afin de loger ses acquisitions hebdomadaires, il déménagea les meubles de l’arrière-boutique et les porta à l’entresol : c’était un commencement de magasin.
Puis l’idée lui vint de renoncer au marchand en gros. A quoi bon, en effet, conserver un intermédiaire inutile ? Ne pouvait-il point s’adresser en personne au fabricant ? L’une des principales conditions qui font le négociant, c’est de tirer de première main les marchandises qu’il veut livrer à la consommation. Le marchand de nouveautés prit donc un cabriolet et se mit à courir les dépôts de fabriques. Il trouva des parties de marchandises avantageuses ; il les marqua de sa griffe et les fit porter à son magasin. Les meubles quittèrent l’entresol et montèrent plus haut. Entre les deux fenêtres de l’entresol il posa une enseigne ; au-dessus il écrivit : Grands magasins de nouveautés. Et tout fut dit. Il était négociant : le boutiquier avait vécu !
Cela fit événement parmi la boutique de Paris. Chacun prit parti pour ou contre l’audacieux novateur. Les vieillards indignés lancèrent l’anathème sur sa race ; ils lui prédirent honte, ruine et banqueroute. Les jeunes gens se mirent à faire comme lui. Alors ce fut par toute la ville une curieuse lutte de façades, d’étalages et d’enseignes. L’amour-propre marchand fit des prodiges. On vit des maisons tout entières se pavoiser du haut en bas, comme les vaisseaux un jour de fête. On vit l’inscription grands magasins à prix fixe courir et se répéter sur la même façade, depuis le rez-de-chaussée jusqu’aux cheminées. Le numéro de la maison fut écrit en chiffres de trois pieds, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, partout.
On perdit deux cents, trois cents aunes d’étoffe en guirlandes d’étalage ; on n’eut point d’enseignes, on eut des tableaux, des tableaux à l’huile, peints sur toile, que l’on payait jusqu’à mille écus : luxe inouï, incroyable, qui pendant dix ans donna un aspect fantastique aux rues Saint-Honoré, Saint-Denis, Neuve-des-Petits-Champs, et commença la pompe merveilleuse des boulevards de Paris. Et tout cela marchait avec la mode ; tout cela variait comme le caprice des femmes, comme la forme d’un chapeau, comme la coupe d’un habit. C’était une étude, c’était un travail prodigieux.
Il y eut des magasins qui changeaient de couleur, qui changeaient d’enseigne, qui changeaient de rue, parce que la rue, l’enseigne ou la couleur avaient cessé d’être à la mode. Et cela se conçoit. Lorsqu’un marchand voyait ses recettes diminuer et le public inconstant porter la vogue ailleurs, placé dans l’alternative de liquider ou de faire faillite, il avait recours aux grands moyens. Pendant huit jours, les quais, les boulevards et les places étaient inondés de bulletins nommés prospectus en langage de magasin ; ces prospectus disaient que le grand établissement du Zodiaque, ou du Solitaire, ou des Vêpres Siciliennes, ou du Vampire (tous noms de mode, comme vous voyez), devant être incessamment fermé, les marchandises contenues dans ces immenses magasins seraient vendues au rabais par cessation de commerce, à trente pour cent au-dessous du prix de fabrique.
Le public y courait, tout joyeux de pouvoir se partager à si bon marché les dépouilles du commerçant fatigué ou ruiné. Grâce à cet empressement, quelquefois tumultueux au point de nécessiter la présence des gendarmes, le marchand jetait par brassées aux acheteurs qui se battaient à sa porte, tout ce que depuis le commencement il avait amassé de vieilles marchandises inférieures, passées, hors de cours, tout ce qu’ils appellent fonds de boutique enfin.
Quand c’était fini, il fermait sa maison, il la faisait peindre et dorer à neuf, il la garnissait de marchandises fraîches ; il changeait son enseigne : aux emblèmes surannés du Solitaire, des Vêpres Siciliennes, ou du Vampire, il substituait un opéra, une tragédie, un drame tout modernes, tout palpitants d’actualité. Et puis de nouveaux prospectus se mettaient à circuler, annonçant au public que l’ouverture des grands magasins de la Dame-Blanche, du Doge de Venise ou de Malvina était irrévocablement fixée à tel jour. Le magasin avait changé de peau comme le serpent. Il recommençait, s’en rapportant pour l’avenir à Dieu ou au tribunal de commerce.
Je crois vraiment, explique Auguste Luchet, que l’annonce commerciale, telle qu’elle existe aujourd’hui, est une création du marchand de nouveautés. Je défie que dans tout le luxueux charlatanisme des publications à deux sous, des journaux à quatre francs et des histoires de France en bronze, on trouve un moyen, un ressort, une malice qui n’ait couru le prospectus des magasins de nouveautés. Quel plus noble appel à la confiance que cette désignation uniforme, prix fixe ? Quel signe plus caractéristique de la probité mercantile que la marque en chiffres connus ? Quelle séduction plus puissante que l’annonce de marchandises impossibles, à des taux tels que la pauvreté infime ou l’avarice sordide n’en ont jamais rêvés ? Cherchez un specimen de journal, une profession de foi d’entrepreneurs, un procédé à souscriptions quelconque où le fallacieux de la rédaction, où la flatterie des formes, où le perfide arrangement des chiffres soient plus puissamment répandus que dans le premier venu de ces mille petits papiers blancs, bleus, verts, jaunes ou rouges, qui vous sont jetés incessamment à tous les coins de rue. Je prends au hasard et je cite : Ouverture Des Grands Magasins Du, etc.
« Le nouveau propriétaire de cet établissement, jaloux de mériter votre confiance et de surpasser même les mérites de son prédécesseur, n’aura jamais recours aux indignes moyens que le charlatanisme ne rougit pas de faire entrer jusque dans les matières les plus respectables. Il a donc l’honneur de prévenir les dames qu’il aura à leur offrir un choix considérable d’étoffes du meilleur goût, à des prix très avantageux, ayant traité des dépôts des principales villes de France.
« Elles rencontreront les plus belles qualités des véritables salins d’Arabie, reps d’Alger tout soie, et la mousseline imprimée des Indes ; châles cachemires, satins et foulards, mousselines thibet pour robes ; mérinos véritable barbe de pacha, chalys, Sumatra, Pondichérys unis et brochés, toiles pour chemises : le tout au-dessous du cours. » Suit une longue nomenclature d’indiennes bon teint à 18 sous, de mousselines blanches à 6 et 8 sous, de calicots sans apprêt, à 10 et 12 sous l’aune, etc.

Au Tapis rouge, magasins de nouveautés et de vêtements pour hommes. Affiche de 1857
Où est l’éloge de journal à trente sous la ligne capable de faire pour cet homme plus que son extravagante annonce ? Il y a là dedans une admirable connaissance du monde. Le public sait très bien que l’on ne fabrique pas de mousselines à 6 sous, ni de calicots à 10 sous ; vingt fois il a été mystifié par les mouchoirs à 2 sous et les cravates à 5 sous ; il n’est jamais arrivé assez tôt pour jouir des châles brochés à 6 francs et des écharpes à 15 sous : n’importe ! Il ira encore où on l’appelle ; il ira toujours ; dans son incorrigible niaiserie, il se figurera éternellement que le dernier qui lui parle dit vrai. Que voulait le prospectus ? Faire venir, pas davantage. Il a réussi. On vient. On s’est dit : « Allons voir ; nous ne serons pas obligés d’acheter. » Vous ne serez pas obligés d’acheter, malheureux ! De quelle nature êtes-vous donc pour vous croire à l’épreuve d’un propriétaire d’établissement ou même du moins adroit de ses commis ?
Sachez donc que le mot impossible n’a point de sens dans la langue de ces hommes. Si tranquillement posé que vous soyez devant leur étalage, si économe de paroles, de gestes, de regards que vous vous teniez, si décidé qu’ils vous voient à jouer le rôle d’une charrette ou d’un cheval arrêtés à leur porte, il y a dans leurs magasins, pendu au mur, plié dans un carton, enfoui sous un comptoir, je ne sais où ni quoi, il y a quelque chose enfin qui est pour vous, que vous marchanderez, que l’on vous vendra, que vous paierez et emporterez, s’il vous plaît !
Plus loin, Auguste Luchet détaille la technique d’accroche du grand magasin lorsque vous vous y trouvez. Un jeune homme au pair est en effet chargé d’y choyer le client. Vous aviez bien besoin, dites-moi, d’aller demander le prix de cette toile de Perse à ramages ! s’exclame le romancier « Entrez, monsieur ! Donnez-vous la peine d’entrer, a aussitôt répondu le jeune homme au pair ; nous avons beaucoup plus avantageux dans l’intérieur. »
Vous entrez. Le jeune homme au pair vous offre une chaise qu’il reprend pour l’écraser de marchandises ; il vous plaint de sortir par un si mauvais temps, quand le soleil inonde l’atmosphère ; en sautant le comptoir, il vous met son pied sur la main ; il ne sait ce qu’il dit, ni ce qu’il fait ; il est fou de joie ! Vous avez marchandé de la toile de Perse, donc c’est une robe de chambre que vous voulez ; alors, voici qu’il vous fait écrouler des avalanches d’indiennes à mettre l’univers en déshabillé, et procédant à ce qu’ils nomment la platine du métier :
« Voici un dessin que vous ne trouverez que chez nous, monsieur ; la maison l’a acheté dix mille francs ; cet autre lui coûte vingt mille francs, perroquet riche : M*** (il cite un nom illustre) l’avait contrefait, le tribunal de commerce l’a condamné à cent mille francs de dommages-intérêts. Ceci se lave comme un linge ; ceci est à l’épreuve des acides ; ceci a été introduit en fraude ; ceci est ce qu’il y a de mieux porté ; le prince de Talleyrand en a fait prendre pour six robes de chambre ; ceci avait été commandé pour la Révolte au Sérail, mais M. Véron n’a pas voulu y mettre le prix ; voici encore quelque chose de tout à fait avantageux : je vous engage à prendre ceci, etc. »

Étourdi, ébloui, épouvanté de ce que vous voyez et entendez, vous restez là planté devant cette montagne de toiles, sans faire un choix, sans dire un prix, trouvant tout cela horrible, maudissant votre indiscrétion de la porte, et vous creusant la tête pour trouver un honnête prétexte de sortir. Quelqu’un est derrière vous, les mains dans ses poches, qui vous a continuellement épié, qui n’a perdu ni un de vos gestes, ni une de vos grimaces ; il vous a vu indécis, mécontent, fatigué ; il dit à l’oreille d’un autre : « L’article coule ! » Aussitôt cet autre s’élance : le jeune homme au pair est poussé, chassé, jeté hors du comptoir ; et, tout ébahi, vous voyez se dresser à sa place un monsieur à favoris, en cravate blanche, boutonné du haut en bas, l’œil vif, l’air riant : c’est le premier commis aux toiles peintes ! Il vient relever l’article que le maladroit surnuméraire laissait couler. Il vous regarde en se mordant les lèvres, se passe la main sur le front, et, culbutant avec dédain le monceau d’indiennes que l’inexpérience de l’aspirant venait d’accumuler, il dit d’une voix forte et brève, comme doit l’avoir tout commis à quatre mille francs : « Réserve ! Indienne fond puce, oiseau de paradis ! » Vous êtes vaincu !
Vous avez l’étoffe, il vous faut maintenant la doublure : c’est du satin blanc. Vous montez au premier. On appelle le soyeux. Le soyeux vient. C’est un fashionable, en gilet de soie noire broché, cravate anglaise à carreaux, redingote noire enrichie de velours, tout soie des pieds à la tête ; un lorgnon et une chaîne mexicaine : ce qu’il y a de mieux enfin. Quelqu’un vous suit toujours, les mains dans ses poches. Quand vous avez fini avec le soyeux, votre suivant vous fait remarquer que vous aurez là une merveilleuse robe de chambre ; puis il vous parle linge, et vous qui avez déjà compris la nécessité d’un sacrifice complet, vous vous laissez pousser au blanc de fil, au blanc de coton.
Le blanc de fil est un homme à gros ventre, à breloques, à gilet jaune, un homme qui fume et boit de la bière, un Flamand pur sang, qui traîne ses mots et vous dit avec une grande tranquillité que la toile de Courtray, blanc de Senlis, pour chemises, revient à infiniment meilleur marché que le calicot. Peu convaincu ou croyant vous sauver par un faux fuyant, vous passez au blanc de coton, doux et frais jeune homme de Picardie, ayant une peau de percale et des mains à rendre une dévote jalouse ; les ongles en amande et des bagues, cela fait bien sur la mousseline. Il vous vend une pièce de madapolam, véritable percale de l’Inde faite à Saint-Quentin. Quelqu’un continue à vous suivre, vous descendez devant lui, devant lui vous traversez un autre magasin, vous montez un petit escalier, vous voilà dans l’entresol, domaine du drapier.
Un Bas-Normand, court, trapu, aux épaules immenses, aux mains tannées, vous reçoit en manches de chemise, et tout en commençant à votre égard la tâche connue sous le nom de enfoncer le margoulin, place et déplace les massives pièces de son ressort avec l’aisance qu’il mettrait à battre des cartes. Vous êtes arrivé là, furieux. Vous avez sur le cœur la doublure de satin blanc et la pièce de madapolam. Vous regardez le drapier de travers, vous êtes fort en face de celui-là ; vous vous vantez de connaître le drap aussi bien que lui. Mais voilà qu’il bouleverse toutes vos idées. Il vous apprend que le cuir de Castres est devenu port de mer, c’est-à-dire rococo ; qu’Elbeuf a tué la fabrique du midi ; il vous apprend que Sedan est une gloire défunte, et que Louviers fait la draperie noire bien plus avantageusement.
Vous sortez de là, battu, contrit, humilié, emportant deux pantalons et une redingote. Puis quelqu’un vous conduit à la caisse, non sans avoir fait de son mieux pour vous livrer à un autre monstre, le châlier, tentative que vous avez repoussée fort brutalement. Quand vous avez payé, quelqu’un vous suit encore jusqu’à la porte et là vous salue profondément ainsi : « Quand vous aurez besoin d’autre chose, monsieur. » Ce quelqu’un est le propriétaire de l’établissement.