La vie familiale autrefois

Dans les livres d’histoire , la « petite histoire « , celle de chaque jour, n’y sera pas écrite. Et pourtant, au fil des siècles, elle a créé l’Histoire. Mais comment vivaient les familles artisanes de cette » petite histoire » ?
Ce que nos parents nous ont dit et ce qu’ils ont vécu au » siècle dernier « .
Le XXe siècle a été celui des plus : plus de communication (radio, transports, téléphone, télévision, électronique, Internet….), plus de santé (progrès de la médecine, de l’hygiène, longévité accrue, maîtrise de la fécondité, Sécurité sociale….), plus de confort (appareils ménagers, avec en premier lieu le lave-linge, eau courante, électricité, chauffage…), plus de mécanisation (agricole, industrielle…), plus de libéralisation (vote et droits des femmes, travail, relations humaines…).
Inversement, ce siècle nous aura bien servis ! Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les conflits sont devenus mondiaux particulièrement meurtriers. On espérait que le mot guerre disparaîtrait du vocabulaire, mais l’actualité prouve chaque jour le contraire dans bien des points du globe, et les dictateurs ont toujours pignon sur rue. L’épuration ethnique et les famines perdurent, alors que les richesses n’ont jamais été aussi importantes. L’homme a la mémoire courte, même s’il est allé sur la Lune… Siècle de paradoxes, d’espoirs, il se divise en gros en deux parties : avant-guerre et après-guerre, où tout s’est accéléré.
La naissance
Les futures mamans actuelles auraient été terrifiées à l’idée d’accoucher dans les conditions de leurs aïeules. Avant 40, l’accouchement se faisait à la maison, avec l’aide d’une sage-femme – quand il y en avait une – ou d’une voisine expérimentée, dans une hygiène et un confort douteux. Seules les citadines se rendaient à l’hôpital ou en clinique. A la campagne, on faisait avec les moyens du bord : eau bouillie, serviettes et bonne volonté. Les hommes n’assistaient qu’exceptionnellement aux naissances. Il fallait une farouche volonté aux intervenants : aux mères, pour qui c’était l’heure ; à l’assistante, qui devait faire preuve d’adresse ; au bambin enfin, qui devait s’accrocher à sa vie toute neuve. Quand cela se passait mal, la sage-femme ondoyait le bébé : elle baptisait l’enfant, un droit accordé par le curé de la paroisse. La mortalité infantile était élevée, surtout lors des naissances et des épidémies.
Les choses ont bien changé avec la surveillance médicalisée de la grossesse et de l’accouchement, la plupart du temps par un spécialiste. Les naissances à la maison sont rarissimes, et de toutes façons médicalisées. L’hygiène évite les complications. Puis la » Sécu » est arrivée…

L’enfance
Cette première épreuve passée, il fallait grandir. Pour un garçon, né à la campagne, le seul moment où il pouvait jouer avec ses copains était pendant la récré à l’école. Dès 7 ou 8 ans, il lui a fallu donner un coup de main à ses parents aux champs. C’est d’ailleurs l’origine des vacances d’été pour les enfants, une main-d’œuvre indispensable et bon marché à la campagne. Dans leurs jeux, les enfants marquaient les saisons. A l’automne, les garçons jouaient aux gendarmes et aux voleurs et à saute-mouton L’hiver laissait la place aux bagarres de boules de neige, au patinage sur les pièces d’eau gelées ; on faisait de la luge, et, en montagne, du ski avec des douves de tonneaux fixées aux chaussures avec des lanières ! Les billes en terre marquaient immanquablement le retour du printemps. Celui qui en possédait une en verre était très important et envié. Et les toupies ! L’été, on passait ses vacances aux champs. On faisait les foins, on menait le tracteur ou le cheval… Heureusement, l’enfance reprenait le dessus, et le ramassage des pommes de pins pour allumer le feu se transformait rapidement en batailles acharnées. On allait aussi dénicher les oiseaux, pêcher à la main, fabriquer des sifflets, des lance-pierres… A cette époque, les filles jouaient à la marelle, au cerceau, se cachaient pour se moquer des garçons qui fumaient pour faire les hommes, et souvent n’importe quoi : clématite, sureau… Après-guerre, les jeux ont radicalement changé, les clubs de sports sont apparus, et plus tard les jeux vidéos !


Dans les villages, certaines familles comptaient parfois 8 enfants, mais aussi jusqu’à 10 ou 12. Dans ces familles nombreuses, c’était un bonheur que d’avoir un fils prêtre, une fille religieuse. Tous allaient au caté, la Communion était obligatoire pour pouvoir se marier plus tard. On y allait le jeudi, ou avant midi, avant ou après l’école. Le curé nous disait des choses qu’on ne comprenait pas, mais qu’on devait apprendre pour le cours suivant. Le plus dur, c’était d’aller à confesse. Certains garçons avaient le » privilège « , un grand honneur, d’avoir été choisi par le curé pour servir la messe comme enfant de chœur. Les catholiques faisaient » la Petite Communion » puis » la Grande « , la Communion Solennelle.
La famille
Avant la guerre, beaucoup de familles étaient pauvres, alors il fallait se tenir les coudes. Les Allocations n’existant pas, il était courant dans les villages d’aider les familles nombreuses. Trois générations vivaient sous le même toit : aux grands-parents le rôle d’éducateurs, de conteurs : c’est ainsi que se transmettait la mémoire (recettes, couture, travaux des champs ou techniques du bois…). Les parents travaillaient dur pour assurer le quotidien. Enfin, les enfants aidaient en dehors de l’école : garde des bêtes aux champs, aide aux travaux de la ferme ou dans le commerce familial. Cette éducation donnait une maturité plus précoce aux enfants.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la qualité principale de nos compatriotes n’est pas d’être polyglotte. Pourtant… Les paysans, majoritaires dans nos régions au début du XXe siècle, l’étaient. A défaut d’être officielle, la langue principale était le patois, qui se parlait entre adultes qui eux, parlaient français aux enfants. On se souvent que nous amusait beaucoup d’entendre des enfants ne parlant que le patois. Il nous arrivait de le parler à l’école entre nous, pour que la maîtresse ou le maître ne comprenne pas. Ce qui était sévèrement réprimé, le français était imposé par l’Éducation. Après le Certificat d’études, on abandonnait l’école et on n’avait pas d’intérêt pour apprendre les langues étrangères. Actuellement l’école obligatoire jusqu’à 16 ans permet aux enfants d’étudier d’autres langues dès la 6ème. Mais le patois n’est pas mort, à voir le nombre de groupes patoisants qui se développent. Après tout, il fait partie de notre patrimoine.
L’école
Une période de l’enfance qui certainement marque les esprits, c’est celle de l’école.
Jusqu’en 1930, filles et garçons étaient dans la même classe. La mixité reviendra dans les années 1960. A la fin des années 1960, presque toutes les écoles primaires sont mixtes. Dans certains villages, la mixité n’existait pas. Il y avait des institutions religieuses qui recevaient les enfants des familles aisées. A la campagne, c’était différent, il n’y avait qu’un instituteur qui regroupait tous les enfants dans une même classe. Les grands aidaient les petits, et tous profitaient des cours des uns et des autres. Les élèves, culottes courtes pour les garçons, portaient la blouse grise. Quand elle était sale, on la retournait avant de la laver.

L’instituteur était une personnalité importante du village. Quand on tuait un cochon, ou quand on récoltait les légumes ou les fruits, il y en avait toujours pour le maître ou la maîtresse. Tout le monde participait à la vie matérielle de la classe : apporter le bois et le petit bois pour le poêle, balayer la classe et la cour, nettoyer le tableau et les pupitres, remplir les encriers… Dans les écoles catholiques, la discipline était stricte, les filles scrupuleusement séparées des garçons, avec port de l’uniforme obligatoire. A l’école primaire, le premier but était le Certificat d’études primaires, disparu au début des années 60. Le » certificat » en poche, on devenait important et on pouvait commencer à travailler pour de vrai.
Malgré l’obligation de suivre une scolarité jusqu’à 16 ans, on s’aperçoit qu’aujourd’hui, certains élèves de 6ème savent à peine lire… En revanche, ils se débrouillent très bien dans de nombreux autres domaines, tels que la vidéo ou l’informatique. La désertification des campagnes dans l’immédiat après-guerre a fait que de nombreuses écoles ont été fermées, faute d’élèves. Mais avec l’apparition des rurbains, qui vivent à la campagne et travaillent en ville, certaines écoles renaissent. La » petite école » restera toujours cette période qui marque l’enfance : tous se souviennent de leur maîtresse, chérie ou détestée, c’est selon…
L’adolescence
La Communion solennelle passée, on entrait dans l’adolescence. Plus enfant, pas encore adulte, et de toutes façons incompris, ça n’a pas changé. Aux alentours de la dernière guerre, on avait le droit de sortir surtout les garçons à la condition expresse de rentrer à l’heure. Les seuls moyens de locomotion étaient les jambes, un peu plus tard les vélos. On descendait en ville avec un peu d’argent qu’on avait gagné en ramassant faisant de petits travaux ou en aidant un voisin… On allait alors au cinéma. Une fille se souvient : » Quand ceux des villages alentour descendaient, ils étaient habillés en dimanche, il fumaient comme des hommes. Leurs cheveux étaient gominés et ils avaient toujours un peigne sur eux, histoire d’être présentables. Bien sûr, les garçons nous regardaient de loin, ils n’osaient pas s’approcher de nous. On en riait. Ceux de ma ville étaient assez méprisants envers ces paysans. J’avais 13 ans quand j’ai rencontré mon futur mari, lors d’une vogue où mes parents nous avaient emmenés… « . Dans ces fêtes annuelles de villages, il y avait un bal… mais les parents veillaient : fréquenter, ça ne se faisait pas.

On tirait à la carabine, au casse-bouteilles, on tentait sa chance à la loterie ou on faisait du zèle avec les voitures tamponneuses. Le fin du fin, c’était de gagner une bouteille de mousseux ou de Clairette, aussitôt bue entre copains, ou ramenée fièrement à la maison. Les adolescentes enviaient les grandes qui avaient le droit de danser, ou qui osaient. Alors, elles restaient entre elles à rêver et à regarder en coin. Entre filles et garçons de cet âge, il y avait un respect et une curiosité mêlés de crainte. On était fauché, alors pour les garçons, les » bonnes-amies « , ce n’était pas gagné d’avance ! Que cette période était donc sage ! (enfin presque…)
Ce n’est que vers les années 60 que l’adolescence a commencé à être prise en considération. Sans pour autant laisser tout faire, les parents sont devenus plus tolérants, plus à l’écoute. On n’apprend plus comment » on fait les bébés » dans les cours d’école, mais à l’école.
Le soir à la veillée, en hiver, le grand-père me racontait des histoires terrifiantes aux enfants. On allait chez les voisins passer la soirée. Ils avaient la TSF, et on écoutait les chansons, les pièces de théâtre, les réclames. Les hommes ennoyaient, teillaient le chanvre, ou ils jouaient aux cartes. Les femmes filaient, tricotaient, les filles brodaient leur trousseau en lorgnant sur les garçons. On chantait au son du violon, de l’harmonica ou de l’accordéon. On mangeait les gâteaux préparés pour l’occasion, émondait les châtaignes ou les noix … L’information locale circulait.



Le service militaire
Le grand-père, parfois le père avaient fait la grande guerre de 14-18, où ils avaient perdu un frère ou un membre de la famille à Verdun ou dans les tranchées. C’est dire si leur patriotisme était ancré. Le jour où un garçon était déclaré » Bon pour le service armé « , la famille était très fière. S’il était réformé, un sentiment pénible d’humiliation s’installait. L’heureux élu et ses copains allaient faire les conscrits, au son du clairon, cocardes et drapeaux en exergue. Au retour de son service, » il était un homme « .

Pour les jeunes gens de 20 ans, le service militaire était la charnière entre l’adolescence et la vie d’homme. Après l’armée, ils pouvaient fonder un foyer, entrer dans la vie. Les jeunes filles restaient au domicile parental, au moins jusqu’au mariage, patriarcat oblige. A la campagne, seuls les garçons pouvaient aller travailler en ville, pour les filles, pas question. Ou alors elles étaient placées dans des familles bourgeoises comme » bonnes « . A 20 ans, les filles secondaient leurs mères dans les travaux de la maison, s’occupaient des plus jeunes, ou étaient vendeuses dans le commerce paternel: pas question de ne rien faire. En ville, elle devenaient ouvrières, occupaient des emplois modestes. Mais on leur apprenait surtout à devenir de bonnes épouses, de bonnes mères. Souvent, une des filles se sacrifiait pour s’occuper des vieux parents. Dans les années 50/60, l’émancipation féminine leur a permis de devenir indépendantes, d’accéder aux études, d’avoir un métier, et surtout de se marier avec celui qu’elles avaient choisi.
Le mariage
Auparavant, cette sacro-sainte institution qu’était le mariage ne se concevait pas sans l’accord des parents, en ville comme à la campagne, où on était encore plus strict. Les fiançailles étaient un passage obligé, dûment fêté. Souvent, les rencontres étaient arrangées par les parents : pour ces mariages d’amitié plus que d’amour, la dot ou la hauteur du tas de fumier devant la ferme étaient primordiales. A la ville, épouser une rurale était mal vu. Quant à la sexualité, sujet tabou par excellence, on était un peu moins regardant avec les garçons qu’avec les filles. Le garçon souriait lorsque sa mère disait : » Rentrez vos poules, mes coqs sont lâchés ! » Mais il n’était pas question de » faire Pâques avant les Rameaux « . Les filles-mères étaient nombreuses, le crétinisme bien présent. Si une fille tombait enceinte, c’était la porte ou le mariage forcé, devant le maire et le curé, mais sans la robe blanche, réservée aux jeunes filles. Le concubinage est entré dans les mœurs, le divorce est plus facile et plus courant, les mariages civils sont de plus en plus nombreux, même si la traditionnelle messe de mariage perdure.

Le situation suivante était assez banale. Le père agriculteur décède avec une succession de huit enfants à laquelle se greffe une histoire de partage entre les héritiers nécessitant la vente de la propriété. L’aîné de la famille reprend la ferme avec une des sœurs. Les autres étaient partis travailler en ville et s’étaient embauchés sans problème à cette époque ; même si les salaires étaient plus modestes, il n’y avait pas d’exclus. A l’usine, on travaillait 10 h. par jour, quelquefois plus. Pour ceux qui étaient restés à la ferme, les vacances, ce n’était pas possible. Ceux de la ville avaient deux semaines ; alors on allait leur donner la main pour les foins, les moissons, et pour le plus grand plaisir de leurs enfants qui découvraient un autre univers.
Un autre exemple, celui d’un propriétaire de magasin qui restait fermé une quinzaine de jours en été, pour partir à la mer. En 1936, Léon Blum avait instauré les congés payés pour les salariés, et même si le propriétaire ne l’était pas, il avait décidé de prendre des vacances. Il est certain que les vacances ont été une révolution dans les mentalités. Aller dans les îles était impensable il n’y a pas si longtemps. Aujourd’hui, les retraités font des voyages organisés chaque fois que leur budget les y autorise. Bien des villages de montagne, grâce aux congés, sont devenus des stations touristiques d’été et d’hiver.
La mort
Lorsqu’un aïeul mourait de sa belle mort, dans son lit, le curé venait lui donner l’Extrême-Onction. Le glas avait informé le village qu’il était parti, et aussitôt les voisins et les amis sont venus nous soutenir. Tout le monde s’est relayé deux jours durant pour le veiller. Souvent il avait droit à un enterrement de deuxième classe suivant le budget de la famille. Le cortège qui emmenait le défunt au cimetière après la messe était ouvert par le curé et les enfants de chœur. Les gens saluaient au passage. Derrière le corbillard, il y avait la famille, les hommes, puis les femmes et les enfants. Après la sépulture, les hommes allaient au café, et les femmes rentraient préparer le repas pour la famille. La crémation, alors preuve d’anticléricalisme, n’existait pratiquement pas. Maintenant, on ne meurt plus chez soi, et les Pompes Funèbres prennent en charge les cérémonies, civiles et religieuses. Les dons du corps à la médecine, puis les dons d’organes, sont entrés dans les mœurs.
Bien sûr, les extraordinaires progrès de la médecine en quelques décennies, ont repoussé la mort à un peu plus tard. Au début du siècle, les soins étaient empiriques, limités et chers. On faisait avec ce qu’on avait sous la main, plantes et remèdes de bonne femme, quelquefois catastrophiques. La gnôle et les saignées étaient les panacées, ou alors c’est le vétérinaire qui opérait dans les conditions d’hygiène qu’on imagine. Les antibiotiques n’existant pas, les épidémies faisaient des ravages, la septicémie aussi. Faute d’argent, souvent on payait le médecin avec des œufs, du beurre, des légumes… Il y avait le rebouteux, ou rhabilleur, dont la médecine n’était pas le métier, mais qui quelquefois faisait des miracles.
Aujourd’hui l’espérance de vie s’est allongée, les soins sont accessibles à tous grâce à la Sécurité Sociale, l’hygiène est plus stricte et le nombre de centenaires a considérablement augmenté.
On sait, d’instinct ou par preuve scientifique, que l’alimentation est primordiale pour la santé. Avant le développement des transports et des techniques de conservation, on mangeait les produits de la ferme et du jardin, suivant les saisons. Il était impensable, jusqu’à récemment, de manger des fraises en décembre, et personne ne connaissait le goût des fruits exotiques. L’orange de Noël avait une saveur particulière. A la campagne, on vivait en auto-production. La base de la nourriture était constituée de pain, de pommes de terre, de soupe (matin, midi, soir) ; on buvait de l’eau, du cidre, ou du vin de sa vigne. En décembre, on tuait le cochon, dont la viande, salée ou fumée, serait consommée une bonne partie de l’année. La carence en iode (pas de poisson de mer) faisait des goitreux.
Personne aujourd’hui ne s’étonne de manger des huîtres, de l’ananas frais, ou des pizzas congelées. L’amélioration de l’agriculture permet des productions toujours plus importantes, qui quelquefois finissent dans les cours des préfectures. Est-ce qu’on mange mieux que naguère ? Peut-être, encore qu’avec les poulets, puis les porcs à la dioxine, la » vache folle » et les pesticides, on peut en douter. Mais certaines affections dues à l’alimentation ont disparu, malgré tout. Et puis les produits bios, qui étaient les seuls existant autrefois, reviennent à la charge.
L’eau et l’électricité
Autre progrès d’importance pour la vie quotidienne, l’arrivée de l’eau courante et de l’électricité dans les foyers. Dans les années juste avant la guerre, les maisons étaient équipées en 110 volts . On avait rangé dans les placards les lampes pigeon et les lampes à pétrole ou à huile On avait une ampoule par pièce, mais pas question de gâcher. Quelquefois en hiver, les poteaux électriques cassaient sous les orages ou sous le poids de la neige. On ressortait les bougies pendant huit jours, le temps que les agents viennent réparer. Après la guerre, de plus en plus de maisons étaient équipées en eau courante, avant on avait juste un robinet d’eau froide à l’évier; certaines familles allaient chercher l’eau au bassin.

Pour se laver, une fois par semaine, il y avait le baquet, qu’on remplissait d’eau chauffée sur le fourneau. On se lavait tous avec la même eau les uns après les autres… L’été on se lavait au bassin, ou dans la rivière. Beaucoup de gens ne se lavaient jamais… Pour les besoins naturels, il y avait une cabane en bois dehors, derrière l’écurie ou au fond du jardin, mais en hiver on allait à l’écurie, et on avait des seaux de nuit dans les chambres.


Avec l’eau courante, les logements ont enfin pu s’équiper de toilettes et de salles de bain, avec eau chaude. Le fourneau à bois, le Godin bois-charbon, était le moyen de chauffage avec la cheminée ancestrale. Dans nos régions, les forêts étaient ainsi toujours entretenues, par le ramassage du bois mort et les coupes. On ne chauffait que la cuisine. Quand on allait se coucher, on emportait une bouilloire, une brique ou un fer à repasser chauffés et entortillés dans un linge pour réchauffer les lits. Quelquefois, les enfants des campagnes faisaient leurs devoirs à l’écurie, où il faisait plus chaud.


Puis le chauffage central s’est développé, on utilise le gaz, le fuel et l’électricité pour les chaudières. Dans certaines villes, on a installé des usines d’incinération des déchets ménagers, qui produisent de la chaleur pour chauffer tout un quartier. L’électricité est partout, même s’il y a régulièrement des polémiques sur le nucléaire, et sur le monopole d’EDF, qui remonte à 1950… On s’intéresse de près aux énergies » douces » : éoliennes, panneaux solaires…
L’argent et l’épargne
A la naissance des enfants, le père ce famille ouvrait un livret de Caisse d’Épargne, alimenté par les oncles, tantes, marraines ou parrains, lors des anniversaires de l’enfant ou pour Noël. Les petites sommes offertes aux étrennes ou quand on avait bien travaillé, allaient directement sur le livret pour plus tard. Ainsi un petit pécule est constitué au long des années. L’argent de poche, il y en avait pas, ou peu. D’ailleurs, on n’en avait pas réellement besoin. On avait quelques envies bien sûr, mais pas autant qu’aujourd’hui.

Dans les villages, le peu d’argent amassé ne circulait pas. Il fallait économiser les sous Les seuls revenus provenaient de la vente des produits du jardin, des œufs et du beurre au marché, ou de la vente d’une bête à la foire. Mais c’était tout. On empruntait rarement, ou de petites sommes à des voisins, en confiance. Pas de contrats, une parole était une parole. Pour gagner des sous, les enfants faisaient de menus travaux. Hormis le livret de Caisse d’épargne, on ne connaissait que peu les banques. Celui qui avait de l’argent n’en parlait surtout pas, et vivait de la même manière que son voisin désargenté. La situation a bien changé, et aujourd’hui presque tout le monde s’endette pour sa maison, sa voiture, ses meubles… L’argent est devenu virtuel : cartes bancaires, chèques, virements, l’âge d’or des banques n’est pas terminé.
Les moyens de transports
Avant l’avènement de l’automobile, on ne se déplaçait qu’en cas de nécessité absolue et il fallait prendre le train. Faire 100 km, c’était aller au bout du monde ! Les petits trajets quotidiens se faisaient à pied ou en char-à-bancs tiré par un cheval. C’étaient les seuls moyens de locomotion. Dans les montagnes, l’hiver venu, on se servait de skis ou de luge… mais il fallait remonter, en général chargé. A partir de 1945, l’automobile s’est développée mais restait malgré tout très chère. On utilisait beaucoup le vélo, y compris pour partir en vacances. Puis les motocyclettes, et leurs petites sœurs les » pétrolettes « , sont arrivées. Il restait cependant un petit problème : pour conduire, il fallait passer le permis. A cette époque seuls les hommes pouvaient conduire, pas question pour les femmes de passer le permis ! C’est à partir de 1914 que les femmes sont de plus en plus nombreuses à vouloir obtenir leur certificat. L’année 1976 marque un tournant dans l’histoire automobile puisque les femmes sont plus nombreuses que les hommes à obtenir leur permis de conduire . Avec le développement des loisirs et l’industrialisation, les transports ont fait un bond spectaculaire ; le TGV vous emmène à Paris en peu de temps., en une journée, vous êtes à l’autre bout du monde ! C’était inimaginable il y a seulement 50 ans.

Le commerce
En ville, les commerces étaient spécialisés : il y avait les épiciers, les bouchers, les boulangers, les merciers, les quincailliers, les droguistes, les couteliers, les cafetiers… Dans les campagnes, il y avait toujours un épicier chez qui on trouvait presque tout.
Certains villages plus importants avaient plusieurs épiceries, boulangeries et plusieurs cafés. » Là où Dieu construit une église, Satan installe un café « , disait-on. C’était un lieu exclusivement masculin, lieu de toutes les conversations, où l’on faisait des affaires, où l’on refaisait le monde. Souvent, on y trouvait du tabac, à côté un jeu de boules. Les grosses journées étaient le dimanche après la messe (et aussi pendant…). On y servait le rouge, le blanc et l’absinthe avant qu’elle soit interdite. Les jeunes fils y venaient avec leur père et avaient droit à un verre de limonade ou de sirop. Ah ! l’ambiance, les odeurs, les bruits des bistrots… Avant les années 60, une femme qui entrait au café était mal vue. Beaucoup de ces établissements, surtout en campagne, ont fermé, à cause de la désertification des villages. Ou alors, ils ont été transformés en restaurants à spécialités… Dans les bars actuels, toutes sortes de boissons peuvent être consommées. La plupart du temps, il y a une télévision pour les rencontres sportives, et les filles, les femmes, même seules, y ont largement fait leur entrée.


Autrefois, le colporteur venait une ou deux fois l’an : toujours bien accueilli, il dépliait sa balle dans laquelle les femmes trouvaient des trésors de mercerie, pour se remettre à neuf. Avec ses marchandises, il apportait les nouvelles locales et aussi les nouvelles des familles éloignées qu’il rencontrait au cours de ses pérégrinations.
A la fin des années 40, la camionnette de l’épicier tournait dans les villages, une ou deux fois par semaine, à jours fixes. Pour ceux qui n’avaient pas de moyens de locomotion, ce fut une aubaine. Elle passait de ferme en ferme, annonçant son arrivée en klaxonnant. Le marché à la ville était le point de ralliement des paysans des environs : on s’y donnait les dernières nouvelles du hameau, et les hommes finissaient au café du coin. Chez l’épicier du village, on faisait marquer et on payait une fois tous les 15 jours, ou chaque semaine.
Peu à peu la vie s’est accélérée, les super-marchés, les » hypers » et les centres commerciaux ont investi les banlieues des villes. On y a gagné du temps, dépensé plus d’argent et perdu beaucoup en convivialité. Les petits commerces sont de plus en plus rares.
La mécanisation
La mécanisation a révolutionné la vie rurale. Les bœufs et le cheval ont progressivement cessé d’être des outils, pour devenir des instruments de loisirs ou des beefsteaks. Jusqu’en 1945 environ, la plupart des travaux agricoles se faisaient à la force des bras et animaux de trait. La faux, la hache, instruments indispensables mais pénibles, ont été remplacés par des faucheuses tirées à cheval, puis par un tracteur. Les andaineurs, botteleuses, enrouleuses, moissonneuses-batteuses-lieuses et autres machines, ont permis aux femmes de la campagne d’être un peu plus libres, aux enfants de profiter de leurs vacances. La machine à traire a fait gagner beaucoup de temps. Cette automatisation des travaux agricoles ont progressivement rendu la vie plus facile, mais dans le même temps les jeunes sont partis vers les usines, elles aussi de plus en plus mécanisées ; là où il fallait une douzaine d’ouvriers pour une production donnée, un seul, devant sa machine-outil à commande numérique, produit la même quantité en dix fois moins de temps et avec une précision accrue. Toutes les professions ont bénéficié de ces indiscutables progrès techniques, avec pour corollaire, hélas, la montée du chômage. L’ordinateur est omniprésent, et ce, quels que soient les domaines. S’il fallait n’en citer qu’un dont la transformation aura sans doute été la plus spectaculaire, c’est le domaine de la communication.


La communication
A la fin du XIXe siècle, on en était aux balbutiements, avec des inventions comme le télégraphe, puis la TSF. On lisait beaucoup plus qu’aujourd’hui, on écrivait plus. Puis vint la » télé » qui s’est rapidement démocratisée, comme la voiture. Le téléphone à cadran, puis à touches ont permis de se parler en temps réel à des distances considérables. Un ordinateur d’il y a 30 ans occupait une pièce entière, on l’a dans la poche aujourd’hui. Sans parler du téléphone mobile, très cher et qu’on transportait dans une valise il y a une quarantaine d’années, actuellement un peu plus grand qu’une carte de crédit… Et la recherche spatiale qui a transformé la banlieue de la Terre en autoroute au mois de juillet, tout ça pour communiquer toujours plus vite, toujours plus loin, et moins cher. Mais comment donc faisaient-ils » avant » ? Ils faisaient, tout simplement ! Ils s’écrivaient, se rencontraient au café ou au marché, ils lisaient les journaux, bavardaient chez l’épicier, écoutaient le glas, achetaient l’almanach pour tous les jours de l’année. Ils payaient un coup au facteur quand il apportait de bonnes nouvelles.

Les » médias » sont d’une importance de plus en plus capitale au quotidien ; plus un foyer qui n’ait une ou plusieurs télévisions, une voiture, deux ou trois téléphones, et tous ces moyens pour communiquer dans l’instant avec le monde entier. Internet est en pleine explosion… Bref, on communique quelquefois plus facilement avec le Japon qu’avec son voisin. C’est formidable, et c’est aussi dommage…
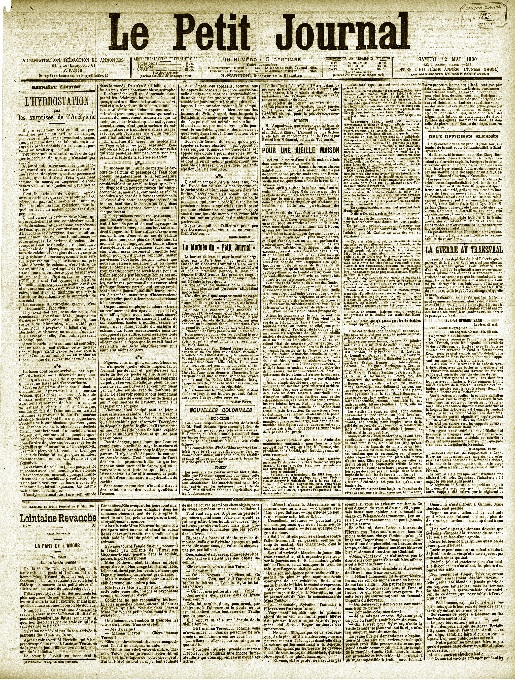
Les petits-enfants savent des millions de choses que leurs grands-parents ne comprennent même pas. Mais ils ont peur du chômage, et poussent leurs études toujours plus loin, sans certitudes. Il font des stages linguistiques aux USA, en Allemagne. Ils ont une voiture et un portable, utilisent la contraception et ne sont pas sûrs de leur avenir. Ils voyagent, par écrans interposés, et ont des amis dans le monde entier. Ils veulent gagner de l’argent, si possible vite et beaucoup. Ils font de nouveaux sports. Certes, la vie paraît plus facile, comparée à celle de leurs grands-parents qui auraient été sidérés devant ce qui est arrivé à leur siècle. Pour rien au monde, leurs descendants ne voudraient rester isolés, perdre tout ce confort que les technologies ont apporté. Et ils ont raison. Mais quelque part en eux, restent ces souvenirs contés par leurs aïeux, en photos quelque part dans des albums jaunis.
